Pour faire une recherche avancée (rechercher des termes dans un type de publication précis), entrez les mots en suivant la syntaxe présentée dans les exemples ci-dessous :
- Harmaguédon Article de revue
- S’excuser Commentaire
- Europe Nouvelles et Prophéties
- Noël Émission
- Baptême Brochure
- Sabbat Roderick C. Meredith
- Avortement Gerald Weston
Évolution ou création: la dimension manquante
La vie a-t-elle évolué par le biais de forces aveugles de la nature ? L’Univers entier a-t-il été créé il y a 6000 ans ? Quelle est la dimension manquante de ces deux théories ?
Chapitre 1
L’enjeu le plus important
Nous vivons sur une planète remarquable. La vie abonde dans chaque recoin de notre monde, aussi bien dans les environnements les plus rudes que les plus accueillants, révélant une variété et une diversité qui semblent infinies. À notre connaissance, la Terre est unique : un îlot de vie au sein d’un Univers dépourvu de vie.
Mais quelle est l’origine de cette vie ?
Les deux réponses habituelles à cette question sont diamétralement opposées, mais leurs partisans les considèrent comme étant certaines. Une de ces réponses propose une évolution s’étalant sur des milliards d’années : l’idée que toute vie sur Terre a évolué au cours de trois à quatre milliards d’années, se transformant et se diversifiant constamment à partir d’un ancêtre unicellulaire, par le biais de processus naturels non guidés et hasardeux.
L’autre réponse est une création divine qui aurait eu lieu il y a environ 6000 ans : l’idée que le Dieu de la Bible a créé l’Univers, la Terre et tout ce qui s’y trouve, il y a seulement six millénaires.
Il serait difficile de trouver deux réponses plus opposées. Et il serait tout aussi difficile de trouver deux réponses défendues avec autant de passion, comme des certitudes absolues, par leurs partisans.
Ces deux propositions ne peuvent être justes en même temps, mais toutes deux peuvent être fausses.
Les preuves physiques qui nous entourent nous obligent-elles à croire en l’évolution ? Une compréhension littérale de la Bible oblige-t-elle à croire en une Jeune-Terre ? Certains faits échapperaient-ils aux deux camps dans ce débat ?
L’enjeu le plus important
Considérez les conséquences si l’une ou l’autre proposition était vraie. Dans le cas de l’évolution, les implications de cette théorie sont graves et ont été mises en évidence par certains de ses défenseurs les plus respectés.
Le célèbre évolutionniste George Gaylord Simpson a conclu que « l’homme est le résultat d’un processus naturel dénué d’objectif, sans intérêt pour lui-même. Il n’était pas planifié. »1 Plus récemment, Richard Dawkins, un des défenseurs les plus connus de l’évolution, a déclaré sans ambages : « Vous n’avez aucune finalité. Vous êtes ici pour propager vos gènes égoïstes. Il n’y a pas de but supérieur dans la vie. »2
Si l’évolution est vraie, un tel raisonnement en serait la conséquence naturelle. Il fut résumé sans détour par William Provine, évolutionniste populaire et professeur de biologie à l’université de Cornell :
« Permettez-moi de résumer mon point de vue sur ce que la biologie évolutive moderne nous dit haut et fort – qui est globalement l’opinion de Darwin. Il n’y a pas de dieux, pas de buts et aucune sorte de force orientée vers un but. Il n’y a pas de vie après la mort. Lorsque je mourrai, je suis absolument certain que je serai mort. C’est ma fin. Il n’y a pas de fondement ultime pour l’éthique, pas de sens ultime à la vie et pas de libre arbitre pour les humains. »3
Ces idées font leur chemin. Selon un sondage réalisé en 2016 auprès de plus de 3000 Américains, 43% des personnes interrogées estimaient que « l’évolution montre qu’aucun être vivant n’est plus important qu’un autre » et 45% sont d’accord pour dire que « l’évolution montre que les êtres humains ne sont fondamentalement pas différents des autres animaux. »4
Pourtant, selon de nombreux évolutionnistes, un taux de 45% est insuffisant et « l’évangile » de l’égalité supposée de l’homme avec les animaux doit être répandu sur toute la Terre.
Cette idée, conséquence naturelle de la pensée évolutionniste, a poussé David Barash, professeur émérite de psychologie à l’université de Washington, à soutenir que la production d’hybrides homme-chimpanzé, peut-être grâce aux techniques modernes d’édition de gènes, constitue pratiquement un impératif moral. Selon son raisonnement, il s’agit d’une « idée formidable » qui détruirait enfin « le mythe théologique le plus blessant de tous les temps : celui de la discontinuité entre les êtres humains et le reste du monde naturel », c’est-à-dire celui de la différence entre l’humanité et le monde animal. Comme l’admet le Dr Barash, des individus hybrides ainsi produits pourraient se rendre compte de leur nature grotesque et se retrouver dans un « enfer vivant », mais il note que « l’avantage ultime d’enseigner aux êtres humains leur véritable nature mériterait bien le sacrifice payé par quelques malheureux. »5
Barash est soutenu dans sa réflexion par Dawkins. Celui-ci considère la croyance selon laquelle les humains occupent une position spéciale par rapport aux animaux comme un mal moral qu’il nomme « spécisme », déclarant que c’est l’équivalent de l’apartheid. Lui aussi a pensé que la création d’un hybride homme-chimpanzé aiderait l’humanité à se débarrasser de ce qu’il considère comme des notions absurdes de la spécificité humaine.6
De telles pensées peuvent sembler extrêmes et j’admets sans problème avoir choisi cet exemple pour son caractère extrême. Pourtant, ces hommes sont très respectés et ne font que suivre la logique de l’évolution jusqu’à ses conclusions naturelles.
Lorsque la société ne voit « pas de fondement suprême pour l’éthique, pas de sens ultime à la vie et pas de libre arbitre pour les humains », est-il si irrationnel de croire que la civilisation deviendra brutale, de manière subtile ou non ? Est-il si irrationnel de soupçonner qu’en nous considérant comme de simples animaux, nous commencions à nous traiter les uns les autres comme de simples animaux ?
Certains répondront rapidement que de telles préoccupations sont irrationnelles, mais l’état actuel du discours politique mondial et le chaos croissant dans les mœurs devraient les faire réfléchir.
La crédibilité de la Bible
Les implications des théories de la « Jeune-Terre » sont tout aussi graves. Les défenseurs de ces théories insistent sur le fait que la crédibilité des Écritures et l’existence du Dieu de la Bible soient en jeu. Selon les créationnistes de la Jeune-Terre, soit la planète Terre n’a que 6000 ans (ou 10.000 ans selon certains d’entre eux), soit la Bible est fausse et ne peut donc pas être la parole de Dieu. Il s’agit là d’une affirmation très grave !
La foi de nombreuses personnes est en jeu. Beaucoup veulent croire que la Bible est vraie, mais trouveront que de telles affirmations sont difficiles à accepter. De nombreux scientifiques affirment que la Terre existe depuis 4,5 milliards d’années, près d’un million de fois plus vieille que les six millénaires défendus par les partisans de la Jeune-Terre. Si le Livre qui est au centre de leur foi est fondé sur une fiction, s’il n’est pas digne de confiance dès son premier chapitre, alors comment faire confiance aux autres affirmations qu’il contient ?
Une compréhension littérale de la Bible exige-t-elle vraiment une Jeune-Terre ? Dans l’affirmative, il faut rejeter bien davantage que la théorie de l’évolution. Si la Bible exige une telle vision de l’univers physique qui nous entoure, comme l’affirment les créationnistes de la Jeune-Terre, alors soit une grande partie des preuves scientifiques est fondamentalement erronée, soit la Bible est fondamentalement erronée.
Si la création elle-même est un témoignage contre le Créateur, personne ne peut nier que l’enjeu soit de taille. Nous ne pouvons éluder la question de savoir si la Bible enseigne la théorie de la Jeune-Terre, celle d’une Terre plus ancienne ou quelque chose d’autre.
Un examen des principales affirmations
Dans les chapitres qui suivent, nous allons examiner les principales allégations de ces deux théories : celles de l’évolution et celles du créationnisme Jeune-Terre. Nous étudierons si les preuves scientifiques soutiennent l’affirmation selon laquelle l’évolution est un fait, puis nous examinerons ce que la Bible dit vraiment au sujet de la création du monde et si elle exige une Jeune-Terre.
Quelles sont ces principales affirmations ? Par souci de clarté, définissons-les dès le départ, en commençant par l’évolution.
Il est incontestable que les animaux peuvent changer dans une certaine limite, ce que l’on appelle souvent la « microévolution ».7 Par exemple, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques et les chiens peuvent être élevés pour « créer » de nouvelles races de chiens. En revanche, la théorie de l’évolution affirme que, sur une très longue durée, des créatures de type bactérien peuvent produire bien davantage que d’autres types de bactéries. Elles pourraient devenir des chiens, des baleines bleues, des palmiers, des aigles et même des êtres humains. En fait, tout cela à la fois.
Lorsque nous employons le mot « évolution » dans cette étude, nous faisons référence à la théorie selon laquelle des processus naturels non guidés, sans but et totalement matérialistes ont produit, à partir d’un simple organisme unicellulaire comme une bactérie, toute la vie sur Terre dans sa variété et sa complexité, au cours de milliards d’années.
Cette idée que toute vie a progressé à partir d’un ancêtre simple et unique par le biais d’une « descendance commune universelle » est alimentée principalement par la théorie avancée pour la première fois par Charles Darwin dans son livre publié en 1859 et qui a fait couler beaucoup d’encre : L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, ou plus simplement : L’origine des espèces.
Dans ce livre, il développa une théorie selon laquelle les processus naturels permettant d’accomplir un tel exploit seraient issus de variations aléatoires et de la sélection naturelle. Les variations aléatoires font référence aux changements qui se produisent au hasard dans la « progéniture » d’un organisme (par exemple, un bec un peu plus long ou une fourrure plus épaisse). La sélection naturelle fait référence à la manière dont ces changements sont « récompensés » ou « punis » dans leur lutte pour la survie. Les créatures qui présentent des changements aléatoires, leur permettant de mieux survivre et de se reproduire (et donc de transmettre leurs gènes à leur descendance), sont qualifiées de « sélectionnées » par la nature pour survivre. Charles Darwin envisageait ainsi une sélection naturelle agissant sur les variations aléatoires et non planifiées qui se produisent dans tous les organismes, façonnant toute la vie au fil du temps, à mesure que les changements réussis s’accumulent et transforment les populations existantes en une diversité croissante de créatures différentes.
Les idées de Darwin étaient révolutionnaires. Avant lui, le concept d’évolution ne disposait d’aucun mécanisme permettant d’expliquer comment des forces naturelles insensibles pourraient produire la variété et la complexité de la vie. Le monde a changé après Darwin. Comme Richard Dawkins l’a écrit, « c’est grâce à Darwin que l’athéisme a pu être une solution pleinement satisfaisante pour l’intellect. »8
Les idées de Charles Darwin ont débouché sur la théorie de l’évolution et elles continuent d’être le pilier central qui soutient l’ensemble de l’édifice.
Voici donc l’affirmation centrale de l’évolution : toute vie sur Terre, dans sa variété et sa complexité, a progressivement évolué au cours de milliards d’années à partir d’un ancêtre commun, simple et unicellulaire, principalement par le biais du processus de sélection naturelle agissant sur d’infimes variations aléatoires et héréditaires.9
En ce qui concerne cette affirmation, de nombreux évolutionnistes se font l’écho du biologiste Jerry Coyne : « L’évolution est un fait. Loin de jeter le doute sur le darwinisme, les données rassemblées par les scientifiques au cours des 150 dernières [années] concourent toutes à le confirmer. Elles montrent que l’évolution a eu lieu et qu’elle s’est déroulée en grande partie de la manière dont Darwin l’avait proposé, suivant les mécanismes de la sélection naturelle. »10 Nous examinerons si une telle conclusion est justifiée ou non.
À l’opposé, nous trouvons le créationnisme Jeune-Terre. L’affirmation centrale de cette idée nécessite beaucoup moins d’explications : la Bible enseigne que l’Univers, et donc la Terre ainsi que toutes les formes de vie qui s’y trouvent, a été créé il y a environ 6000 ans11 et qu’avant cela, il n’y a pas « d’histoire » de la vie ou du monde à proprement parler. Cette position est parfois décrite comme l’alternative à l’évolution. Le débat concernant les origines de la vie est souvent caractérisé par une opposition entre la croyance en l’évolution sur une Terre ancienne et la croyance en la création sur une Terre jeune.
Nous verrons si la Bible enseigne réellement le créationnisme Jeune-Terre et si ce sont vraiment les deux seules options possibles.
Où se trouve la vérité ?
Ces questions ne sont pas réservées aux religieux. Il s’agit plutôt de questions vitales pour quiconque s’intéresse à la vérité. Par exemple, Thomas Nagel, athée respecté, ne croit ni en Dieu ni en la Bible. Il n’accepte pas non plus que le monde qui nous entoure ait été créé de manière intelligente. Pourtant, lui aussi doute de la nature matérialiste de la théorie de l’évolution :
« Il est à première vue très peu plausible que la vie telle que nous la connaissons soit le résultat d’une succession d’accidents physiques associés au mécanisme de la sélection naturelle […] Mon scepticisme n’est pas fondé sur une croyance religieuse, ni sur une croyance en une alternative définie. Il s’agit simplement de la conviction que les preuves scientifiques disponibles, malgré le consensus de l’opinion scientifique, ne nous obligent pas rationnellement à nous soumettre à l’incrédulité du sens commun. »12
En fin de compte, ces questions sur l’évolution ou la création sont des questions à propos de la vérité. Les affirmations des évolutionnistes et des créationnistes de la Jeune-Terre ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses toutes les deux.
Dans les prochaines pages, nous allons examiner ces affirmations. Nous commencerons par l’évolution et nous examinerons si les preuves physiques établissent réellement que cette théorie est un « fait ». Ensuite, nous nous tournerons vers la Bible pour voir si elle enseigne réellement que toute la création est apparue il y a seulement 6000 ans, ou si elle enseigne quelque chose de bien différent. Enfin, nous conclurons en formulant des recommandations à l’intention de tous sur les mesures à prendre.
Chapitre 2
Ce que révèlent les fossiles
Pour beaucoup, le mot évolution évoque des images mentales de fossiles, ces restes d’anciennes formes de vie, visibles sous la forme d’os pétrifiés ou d’empreintes dans la roche. Quel enfant n’a jamais été émerveillé par le squelette reconstitué d’un tyrannosaure dans un musée et ne s’est jamais demandé quel genre de créature pouvait jadis parcourir la Terre ?
Les fossiles nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous indiquent que le monde d’alors était très différent du nôtre à bien des égards. Les roches nous montrent une vaste ménagerie d’animaux, petits ou gigantesques, dont la plupart n’existent plus aujourd’hui. Dans le cas du tyrannosaure mentionné au paragraphe précédent, la plupart d’entre nous sont ravis que ces espèces aient disparu !
Une trace du changement et de l’évolution ?
Avant même l’époque de Darwin, les fossiles ont amené de nombreuses personnes à s’interroger sur le monde dans lequel vivaient ces créatures. Certains considèrent les fossiles comme une preuve indubitable que les animaux évoluent au fil du temps et que toutes les créatures vivantes ont des ancêtres communs.
Le fait que les fossiles établissent des points communs entre les êtres vivants est indiscutable. Si certaines similitudes entre les formes de vie passées et présentes sont évidentes (les cages thoraciques, les crânes, les morphologies, etc.), d’autres similitudes sont assez subtiles et nécessitent un examen plus approfondi.
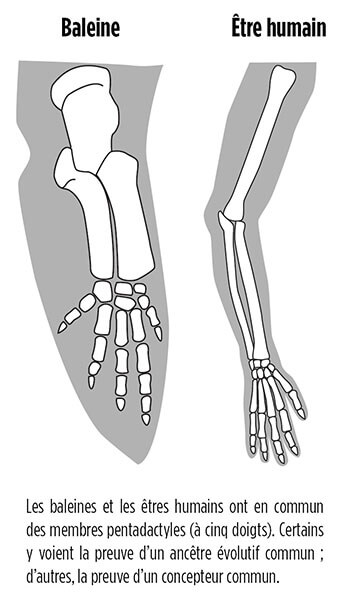
Considérons, à titre d’exemple, la nature pentadactyle (à cinq doigts) des membres de nombreux animaux. La main et le pied d’un être humain, la patte d’un crocodile et l’aile d’une chauve-souris possèdent des éléments communs, basés sur cinq os semblables à des doigts. D’autres membres sont comparables, mais plus éloignés. La structure osseuse de la nageoire d’une baleine rappelle ainsi celle de la main humaine, bien qu’un des « doigts » de la baleine ne soit qu’une simple protubérance.
Pourquoi la structure osseuse de la nageoire d’une baleine ressemble-t-elle à celle d’une main humaine ? Pour les évolution-nistes, la réponse est évi-dente : l’ascendance commune. Le fait que les êtres humains, les chauves-souris et les baleines partagent une telle caractéristique est considéré comme une preuve qu’ils ont tous évolué à partir d’un ancêtre commun possédant cette même caractéristique. Au cours de millions d’années, différentes mutations, favorisées par la sélection naturelle, ont amené les animaux à évoluer de manière à produire des résultats très différents : la main humaine, l’aile de la chauve-souris et la nageoire de la baleine.
Mais pour ceux qui croient que la vie a été créée par une force supérieure, il existe une autre réponse, tout aussi évidente : il ne s’agit pas d’un ancêtre commun, mais d’un Créateur commun.
Les évolutionnistes ont-ils raison ? Les fossiles sont-ils l’histoire, gravée dans la pierre, de l’ascension lente et progressive de la vie depuis un ancêtre commun unique jusqu’à l’immense diversité que nous observons aujourd’hui ? Les archives fossiles exigent-elles d’accepter la théorie de l’évolution ?
Bien au contraire. Dans l’ensemble, les archives fossiles vont à l’encontre de la théorie de l’évolution graduelle et progressive.
Une progression graduelle ou des bonds spectaculaires ?
En examinant l’état des archives fossiles connues à son époque, Charles Darwin reconnut le défi qu’elles représentaient pour sa théorie. Voici ce qu’il écrivit dans L’origine des espèces :
« Mais pourquoi ne trouvons-nous pas fréquemment dans la croûte terrestre les restes de ces innombrables formes de transition qui, d’après cette hypothèse, ont dû exister ? […] La géologie ne révèle assurément pas une série organique bien graduée, et c’est en cela, peut-être, que consiste l’objection la plus sérieuse qu’on puisse faire à ma théorie. Je crois que l’explication se trouve dans l’extrême insuffisance des documents géologiques. »1
Si la vie a débuté il y a des milliards d’années, à partir de quelque chose ressemblant à une bactérie, se transformant lentement et progressivement – par le biais de mutations continues, cumulatives et minuscules – pour devenir la merveilleuse diversité d’organismes que nous observons aujourd’hui, alors Darwin comprenait que les archives fossiles devraient fournir d’abondantes preuves de cette évolution. La croûte terrestre devrait regorger de formes transitoires.
À l’époque de Darwin, il était clair que les archives fossiles ne contenaient pas l’abondance de fossiles de transition que sa théorie nécessitait. Il espérait que des fossiles soient découverts au fur et à mesure, apportant la preuve d’une « série organique bien graduée », un spectre lisse de formes animales présentant de petites différences transitoires entre elles, qui serait également révélée comme étant la « norme ». Cela n’a pas été le cas.
Dans un passage souvent cité, mais rarement placé dans son contexte, le paléontologue Stephen Jay Gould, aujourd’hui décédé, s’inquiéta de l’attitude de ses collègues à l’égard des archives fossiles et de leur réticence générale à admettre ce qui était évident dans les roches (c’est nous qui accentuons) :
« L’extrême rareté des formes transitoires dans les archives fossiles reste le secret de fabrication de la paléontologie. Les arbres évolutifs qui ornent nos manuels ne contiennent des données qu’aux extrémités et aux nœuds de leurs branches ; le reste n’est que des déductions, aussi raisonnables soient-elles, et non des preuves fossiles […]
L’argument de Darwin [disant que les archives fossiles sont incomplètes] continue d’être l’échappatoire préférée de la plupart des paléontologues face à l’embarras d’une histoire qui semble montrer si peu de choses directement liées à l’évolution. En exposant ses racines culturelles et méthodologiques, je ne souhaite en aucun cas remettre en cause la validité potentielle du gradualisme (car tous les points de vue généraux ont des racines similaires). Je souhaite seulement souligner qu’il n’a jamais été “observé” dans les roches. »2
Il convient de préciser que Gould croyait fermement en l’évolution, y compris au rôle moteur de la sélection naturelle, et qu’il avait sa propre théorie pour expliquer la raison pour laquelle il existe des lacunes abondantes et spectaculaires dans les archives fossiles, en contradiction avec la doctrine darwinienne du gradualisme. Il a également été très critiqué pour les « munitions » que ses observations honnêtes ont fournies aux créationnistes et autres opposants de Darwin. De son propre aveu, cette situation l’a laissé un peu « amer ».3
Au cours des années écoulées depuis l’évaluation honnête du registre fossile par le Dr Gould, la situation ne s’est guère améliorée, comme l’a fait remarquer l’anthropologue Jeffrey Schwartz :
« Nous sommes toujours dans l’ignorance de l’origine de la plupart des grands groupes d’organismes. Ils apparaissent dans les archives fossiles tout comme Athéna est sortie de la tête de Zeus : épanouis et prêts à se mettre à l’œuvre, en contradiction avec la représentation de Darwin selon laquelle l’évolution résulte de l’accumulation progressive d’innombrables variations infinitésimales. »4
Tout comme Stephen Jay Gould, le Dr Schwartz proposa une explication aux lacunes des archives fossiles (“l’équilibre ponctué” pour Gould, “les mutations du gène Hox” pour Schwartz). Il semble que de nombreux évolutionnistes ne reconnaissent publiquement les preuves contre la théorie darwinienne que lorsqu’ils ont une idée alternative pour la remplacer. Ce phénomène se produit si régulièrement que Casey Luskin, auteur spécialisé dans l’évolution et le design intelligent, lui a donné un nom : « confessions rétroactives de l’ignorance. » Bien qu’aucune théorie n’ait acquis une fraction de la réputation de plausibilité rationnelle de l’évolution darwinienne, les preuves fossiles ne cessent d’éroder la théorie de Darwin plutôt que de la confirmer. Si les faits ne confirment pas la théorie, dans quelle mesure celle-ci est-elle vraiment plausible ?
Le biochimiste Michael Denton résuma ainsi l’impact de l’absence de formes transitoires abondantes dans les archives fossiles :
« Comme nous le rappelle Steven Stanley dans son récent livre Macro-évolution, l’image globale de la vie sur Terre est à tel point discontinue, les fossés entre les types tellement évidents, que si nos connaissances en biologie s’arrêtaient aux espèces actuellement existantes, “nous devrions nous demander si la doctrine de l’évolution n’est pas autre chose qu’une hypothèse excessive”. Sans formes transitoires pour combler les énormes fossés qui séparent les espèces et les groupes d’organismes existants, on ne pourrait pas vraiment envisager le concept d’évolution comme une hypothèse scientifique. »5
Certains fossiles découverts pourraient sans doute être qualifiés de « formes transitionnelles » car leur apparence suggère qu’ils pourraient se situer le long d’une hypothétique séquence de développement. Les paléontologues vantent souvent les reconstructions théoriques de l’évolution des baleines (depuis un ancien mammifère terrestre appelé pakicetus jusqu’aux baleines actuelles, en passant par plusieurs formes transitoires hypothétiques comme l’ambulocetus et le dorudon, qui vivent dans l’eau), ou encore de celle des chevaux (une séquence de plusieurs animaux théoriquement apparentés, depuis l’eohippus de la taille d’un chien jusqu’au cheval moderne). Ces modèles et d’autres figurent souvent dans les manuels consacrés à l’évolution.
Cependant, la raison pour laquelle ces exemples hypothétiques de « transitions » sont si fréquents dans les manuels est qu’ils constituent les rares exceptions à la règle. Dans les archives fossiles, ce sont les grandes lacunes qui sont la règle et non les « transitions » harmonieuses. Même en acceptant la chronologie standard de la vie sur Terre en millions et en milliards d’années, il faudrait considérer les archives fossiles comme de longues périodes au cours desquelles les animaux n’ont pas changé de manière perceptible. Plutôt qu’un changement progressif, les archives fossiles décrivent des formes radicalement différentes qui sont soudainement « apparues » sans précurseurs évolutifs suffisants ou qui ne correspondent pas aux formes « transitoires » attendues pour combler les lacunes entre les types de créatures.
Les quelques reconstructions hypothétiques de lignées fossiles et les collections de formes transitionnelles ne peuvent tout simplement pas l’emporter sur les preuves incriminantes des grands vides dans les archives fossiles, là où il ne devrait pas y en avoir.
Comme l’a écrit le philosophe des sciences David Berlinski en réponse à ceux qui critiquaient son analyse raisonnée de l’absence de preuves soutenant le darwinisme :
« Dans mon essai, je n’ai pas dit que les archives fossiles ne contenaient aucune forme intermédiaire ; c’est une affirmation ridicule. Ce que j’ai dit, c’est qu’il y a des lacunes dans le cimetière des fossiles, des endroits où il devrait y avoir des formes intermédiaires mais où il n’y a rien à la place […] C’est simplement un fait. La théorie de Darwin et les archives fossiles sont en conflit. Il peut y avoir d’excellentes raisons à ce conflit. Avec le temps, un artefact pourrait se révéler en être une [c.-à-d. une forme intermédiaire]. Mais il n’y a rien à gagner à penser que ce fait évident n’en soit pas un […]
Qu’il y ait des endroits où les lacunes sont comblées est intéressant, mais non pertinent. Ce sont les lacunes qui sont cruciales. »6
En bref, vous pouvez prétendre que les archives fossiles sont le récit d’une évolution graduelle, mais les roches continuent de témoigner contre vous.
Le mystère de l’explosion cambrienne
Aucune « lacune » ne nuit autant à la crédibilité de l’évolution darwinienne que la plus ancienne de toutes : le vide virtuel de vie animale qui précède la période remarquable connue sous le nom d’explosion cambrienne. Datée, selon les mesures traditionnelles, d’environ 500 millions d’années, l’explosion cambrienne est une période du registre fossile au cours de laquelle, apparemment sans crier gare, est apparue soudainement une abondance de formes de vie dont les supposés « ancêtres évolutifs », s’ils ont existé, n’ont laissé pratiquement aucune trace.
Les fossiles de l’explosion cambrienne contiennent des exemples de deux tiers de tous les plans corporels animaux existant actuellement dans le monde, mais les archives fossiles ne montrent aucun précurseur significatif.
L’apparition soudaine d’animaux évolués dans les archives fossiles de l’ère cambrienne a troublé Charles Darwin, qui l’a d’ailleurs honnêtement déclaré dans son ouvrage L’origine des espèces. Sa théorie prévoyait que cette grande diversité d’animaux nouveaux et exotiques trouvés dans les fossiles cambriens devrait posséder un plus grand nombre d’ancêtres également présents dans les archives fossiles. Or, à quelques rares exceptions près, ils sont absents. Pourquoi ? Darwin n’avait pas la réponse, mais il était conscient de son dilemme :
« Pourquoi ne trouvons-nous pas des dépôts riches en fossiles appartenant à ces périodes primitives ? C’est là une question à laquelle je ne peux faire aucune réponse satisfaisante […] Néanmoins, la difficulté d’expliquer par de bonnes raisons l’absence de vastes assises de couches fossilifères au-dessous des formations du système cambrien supérieur reste très grande. »7
Environ 160 ans plus tard, l’événement cambrien est toujours aussi contrariant. Comme le résuma la prestigieuse revue Science, « la grande énigme de l’explosion cambrienne doit certainement être considérée comme un des mystères les plus importants de la biologie de l’évolution ».8
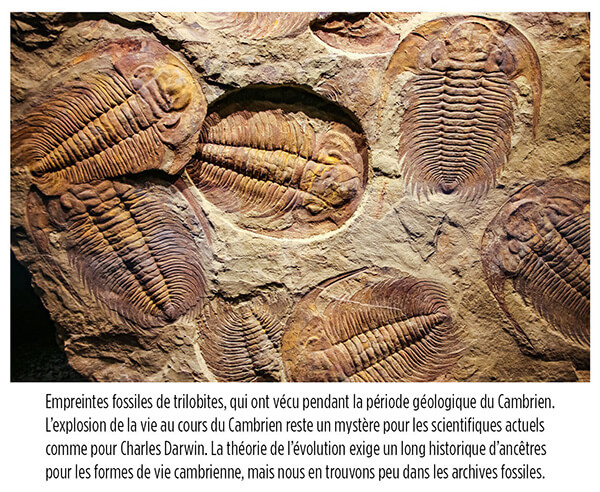
L’évolution ne peut tolérer que des animaux complexes et pleinement développés sortent de « nulle part ». Pourtant, ils sortent bien de nulle part. Certes, les archives géologiques contiennent des fossiles antérieurs à l’explosion cambrienne, mais, pour reprendre les mots de Berlinski, bien que ce soit intéressant, ce n’est pas pertinent. Ce qui est crucial, c’est l’absence remarquable du type de fossiles auxquels nous devrions nous attendre selon la théorie de l’évolution.
En mettant en perspective les vœux pieux et les reconstructions hypothétiques de l’évolution des baleines ou des chevaux, nous constatons que les fossiles ne constituent pas un témoignage convaincant de transitions harmonieuses entre le passé ancien et le monde moderne. Ils sont plutôt un bilan révélateur des lacunes non comblées, d’énormes vides dans lesquels nous devrions trouver une abondance de fossiles démontrant ces transitions évolutives. Mais, à de très rares exceptions près, ils sont significativement plus absents que présents.
Soit les fossiles sont extrêmement timides, soit la théorie qui prédit leur existence est tout simplement erronée.
“L’objection la plus sérieuse” ?
Les archives fossiles auraient pu contribuer à établir la plausibilité de l’accumulation graduelle des petits changements exigés par la théorie de Darwin. Cela n’aurait pas suffi à prouver le bien-fondé de l’évolution. Mais si les roches avaient « coopéré », elles auraient pu apporter un grand soutien à cette théorie. Au lieu de cela, près de 160 ans après que Charles Darwin l’ait décrite, les archives fossiles restent « l’objection la plus sérieuse qu’on puisse faire à [sa] théorie ».
Est-ce vraiment le cas ? Existe-t-il des objections encore plus importantes à sa théorie et à l’évolution naturaliste – des objections que Darwin n’aurait jamais pu imaginer compte tenu de l’état des avancées scientifiques de son époque ?
Il y effectivement des objections encore plus sérieuses. Nous les examinerons au chapitre suivant.
Chapitre 3
La preuve par les yeux
Bien plus que les ossements desséchés de l’Antiquité, c’est la collection déconcertante d’êtres vivants autour de nous qui constitue la preuve la plus facilement accessible contre la théorie de l’évolution. L’appareil vivant et les organes complexes que nous voyons aujourd’hui dans le corps des créatures vivantes semblent défier toute tentative d’explication par des moyens purement mécaniques et aveugles. Comment un organe complexe et coordonné comme l’œil a-t-il pu se « développer » au fil du temps sans l’intervention d’un concepteur ? Comment des structures intégrées et avancées telles que le poumon aviaire pourraient-elles simplement « s’assembler » sans avoir été intelligemment planifiées et conçues ? Nous nous posons facilement de telles questions et Charles Darwin lui-même se les posa. Darwin écrivit dans le chapitre intitulé « Organes très parfaits et très complexes » :
« Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l’œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d’ajuster le foyer à diverses distances, d’admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. »1
Cependant, son commentaire ne doit pas être pris hors contexte, suggérant qu’il pensait que l’œil ne pouvait pas évoluer. Voici ce qu’il écrivit ensuite :
« La raison nous dit que si, comme cela est certainement le cas, on peut démontrer qu’il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant avantageuse à l’être qui la possède ; que si, en outre, l’œil varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce qui est également le cas ; que si, enfin, ces variations sont utiles à un animal dans les conditions changeantes et son existence, la difficulté d’admettre qu’un œil complexe et parfait a pu être produit par la sélection naturelle, bien qu’insurmontable pour notre imagination, n’attaque en rien notre théorie. »2
Cette croyance est au cœur de la théorie de l’évolution : des structures fonctionnelles, utiles et extrêmement complexes, telles que l’œil humain, pourraient être « créées » par de minuscules incréments non guidés et non planifiés sur de longues périodes.
Darwin chercha non seulement à rendre possibles ces scénarios impossibles, mais aussi à ce qu’ils soient considérés comme acquis. Il pensait qu’il pouvait en être ainsi et les évolutionnistes affirment souvent qu’il n’y a pas de place au doute. Est-ce vraiment le cas ?
Parmi les créatures vivantes de notre monde, un nombre considérable d’organes et d’autres systèmes fonctionnels pourraient correspondre à la description de Darwin qui les qualifia de structures « très parfaites et très complexes ». Les incroyables tentacules de la pieuvre, la chambre d’explosion du coléoptère bombardier, le remarquable poumon aviaire… Ces exemples pourraient être multipliés à l’infini, mais concentrons-nous sur l’œil pour illustrer notre propos.
La fable de l’évolution de l’œil
Cet exemple est remarquable. Quiconque réfléchit à sa fonction ne peut manquer de s’étonner des remarquables capacités de « l’œil-caméra » dont dispose l’être humain. Nous nous limiterons à un résumé extrêmement bref du fonctionnement de l’œil, mais cela suffira amplement pour atteindre notre objectif.
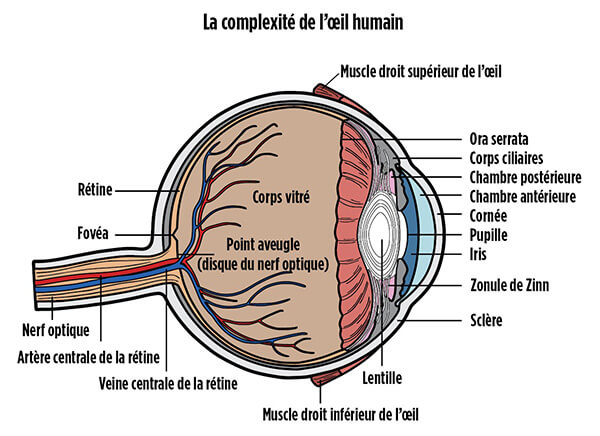
La lumière pénètre par la cornée, qui protège l’œil et aide à focaliser la lumière, puis elle traverse l’iris et la pupille qui en font varier l’exposition. Enfin, le cristallin change organiquement de forme pour parfaire la focalisation de la lumière. Chacun de ces éléments fonctionne au sein d’un système coordonné, « intelligent » et automatique qui s’ajuste dans les moindres détails, à des vitesses très rapides, afin de focaliser avec précision une image sur la rétine. Une cascade de réactions chimiques s’enclenche alors, produisant des signaux électriques envoyés par le nerf optique au cerveau qui, à son tour, les décode et les transforme en informations visuelles détaillées. Ce processus a lieu en permanence, même si le paysage devant vous est en mouvement constant (y compris le texte que vous lisez actuellement), changeant d’un instant à l’autre.
Peut-être parce que Darwin lui-même mentionna l’œil comme un défi pouvant être relevé par sa théorie, cet organe remarquable a été un des sujets d’étude favoris des évolutionnistes cherchant à prouver que la sélection naturelle et la variation aléatoire peuvent vaincre les obstacles et surmonter tous les doutes. Richard Dawkins a décrit à maintes reprises un hypothétique parcours évolutif selon lequel l’œil humain aurait pu se développer à partir d’une simple cellule sensible à la lumière. De nombreuses vidéos cherchant à expliquer sa théorie sont disponibles sur YouTube, mais pour ceux qui sont intéressés par les détails, il est difficile de faire mieux que son explication approfondie dans le cinquième chapitre de son livre Escalader le mont Improbable (Climbing Mount Improbable). Enrichi par des illustrations et par l’éloquence caractéristique de Dawkins, son récit est pratiquement la référence absolue de la théorie de l’évolution de l’œil.
Cependant, la vérité dépend des faits, pas de l’éloquence. Même le pire des mensonges peut être bien raconté.
Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire la longue explication de Dawkins sur la façon dont des cellules simples, photosensibles (sensibles à la lumière), auraient pu évoluer au fil du temps pour former l’œil humain complexe, le biologiste Jerry Coyne en propose un résumé dans son livre populaire intitulé Évolution : les preuves.
« Une succession plausible de changements de ce type commence avec de simples oculaires faits de pigments photo-sensibles, comme on en trouve chez les vers plats. La peau se replie ensuite vers l’intérieur pour former un creux qui protège l’oculaire et lui permet de mieux situer les sources de lumière dans l’espace – les patelles (ou chapeaux chinois) ont des yeux de ce genre. Chez le Nautilus pompilius, on trouve un orifice qui s’est rétréci pour produire une meilleure image, tandis que chez le ver des sables cette ouverture est recouverte d’une protection transparente. Chez les ormeaux, une partie du liquide oculaire a coagulé pour former une lentille qui permet de concentrer la lumière, alors que, chez de nombreux mammifères, les muscles adjacents ont été recrutés pour bouger la lentille et changer son focus. L’évolution de la rétine, du nerf optique et du reste découle naturellement de la sélection. Chaque étape de cette hypothétique série de “transitions” rend son porteur un peu plus adapté, dans la mesure où elle permet à l’œil de capter plus de lumière et de former de meilleures images, deux capacités qui favorisent la survie et la reproduction. Chaque étape de ce processus est plausible, puisqu’on en trouve un exemple dans les yeux d’autres espèces. Cet enchaînement débouche au final sur un œil aussi complexe qu’un appareil photo, dont l’évolution adaptative semblait pourtant impossible de prime abord. Ainsi, la complexité de l’œil final peut être décomposée en une série de petites étapes adaptatives. »3
En tout cas, c’est ce qui est généralement raconté.
Cela pourrait-il vraiment se produire ?
Ce scénario est fréquent, mais la question qui en découle l’est beaucoup moins : cela pourrait-il vraiment se produire ?
Un des problèmes de ce scénario, tel qu’il est généralement raconté, est que les petites étapes décrites comme étant simples sont, en réalité, des étapes bien plus complexes. Fondamentalement, les changements à prendre en compte se situent au niveau génétique : la programmation au sein de l’ADN et ses mécanismes de régulation que les cellules d’un organisme utilisent pour construire les différentes parties de l’œil. Nous examinerons la structure de la cellule et de sa programmation moléculaire au chapitre suivant. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour se rendre compte des problèmes posés par la fable de « l’évolution de l’œil ».
Nous devrions nous poser la question suivante : à quel point certains de ces soi-disant « petits pas » sont-ils petits ? Par exemple, quels types de changements structurels ont été nécessaires dans le tissu situé sous les points photosensibles pour amorcer l’indentation (ou le renfoncement) qui deviendra la cavité oculaire ? Pourquoi cette indentation était-elle ainsi localisée dans la zone de ces cellules ? Quels sont les changements qui l’ont amenée à s’enfoncer et à prendre la forme d’une cuvette ?
Les questions sur ce scénario se multiplient rapidement. Comment l’ensemble des nerfs et des réseaux nerveux s’est-il modifié pour communiquer des informations plus sophistiquées ? De quelle manière la rétine en développement a-t-elle dû être remodelée pour recevoir des images plus complexes ?4 Les rétines telles que celles des humains effectuent un prétraitement de l’image avant de l’envoyer au cerveau. Quelles étapes ont été nécessaires pour permettre cela ? Au sein du cerveau lui-même, quelles fonctions et quelles voies neuronales ont dû se développer pour commencer à traiter des images plus détaillées et les convertir en réponses ?
Pourquoi le mucus transparent de la cavité oculaire en formation se serait-il épaissi près de l’ouverture minuscule chez la descendance mutante ? Quelles sortes de structures se forment pour maintenir cette différence de densité ? Comment sont-elles apparues ? Si la lentille se forme à partir d’un cache placé sur l’ouverture, comment s’est-elle développée ? Quelle machinerie cellulaire a dû être inventée pour produire une telle substance à cet endroit précis ? Quelles sont les caractéristiques biomécaniques innovantes qui ont permis d’améliorer la lentille ? Est-il raisonnable de penser que ces caractéristiques représentent un « petit » changement ?
En étudiant les structures oculaires de divers animaux, les scientifiques se sont rendu compte que beaucoup de ces « étapes » ne seraient pas de petites évolutions, mais des bonds gigantesques qui auraient nécessité des changements physiologiques sophistiqués et coordonnés. À elle seule, l’étude du cristallin montre qu’il s’agit d’une structure remarquablement compliquée et finement ajustée, composée de nombreuses parties, dont la construction implique de multiples détails régis et coordonnés par une multitude de mécanismes et de régulateurs génétiques.5 Il est facile de déclarer que le développement de ces structures se produit par « petites étapes adaptatives », mais les faits ne sont pas de cet avis.
Ces complications sont régulièrement ignorées dans le récit des évolutionnistes, ou passées sous silence comme dans le scénario cité précédemment, comme si le simple fait de mentionner les mots « sélection naturelle » rendait soudainement l’hypothèse crédible.
Songez au point suivant : aucune de ces étapes, petite ou grande, ne peut se produire de manière isolée. Par exemple, aucune amélioration du pouvoir de focalisation n’est un avantage pour la survie si les cellules photosensibles ne sont pas biochimiquement prêtes à recevoir une meilleure image. Il n’y a aucun avantage à obtenir une image plus nette sans un système nerveux capable de communiquer une image de meilleure qualité au cerveau. De même, il n’y a aucun avantage si le cerveau n’a pas développé les systèmes nécessaires pour traiter cette meilleure image. De multiples systèmes dans le cerveau humain traitent les images en analysant les formes, les couleurs, les mouvements et bien d’autres facteurs. En l’absence de systèmes de soutien, la sélection naturelle ne peut « récompenser » l’avantage d’une image plus nette. En fait, les mécanismes de mise au point réduisent généralement la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil, ce qui peut même être négatif pour l’organisme, à moins que le système nerveux soit déjà préparé à traiter des images plus détaillées. Dans ce cas, la sélection naturelle irait à l’encontre d’une telle « amélioration ». Or, il n’y a aucune raison pour que le cerveau augmente ses capacités de traitement d’images s’il n’y a pas déjà des images de meilleure qualité prêtes à être traitées.
L’ensemble du système (qui est bien plus complexe que ce que nous venons de décrire) doit évoluer de concert pour être bénéfique. La « fable de l’évolution de l’œil » ne veut surtout pas présenter un système compliqué, interconnecté et interdépendant, évoluant de manière multiforme et coordonnée. Au contraire, cette fable est présentée comme celle d’un « randonneur solitaire », se frayant un chemin sur un petit sentier de montagne, un pas après l’autre, alors qu’il faudrait en réalité disposer d’un assaut coordonné à plusieurs contre une falaise à pic, travaillant en unité, planifiant chaque étape du parcours et arrivant bien préparés au pied de la falaise.
Mais ce genre de scénario réaliste n’est pas le genre d’histoire que l’évolution est autorisée à raconter, car cela ne soutient pas le récit d’une accumulation graduelle et non planifiée de changements infimes, à peine perceptibles.
Lorsque le premier scénario est examiné comme il devrait l’être par un scientifique qui se focaliserait sur des détails réalistes et irréfutables confirmant ce qui doit réellement se produire et qui n’accepterait pas avec complaisance de vagues déclarations masquant ces détails complexes mais essentiels, alors ce scénario apparaît pour ce qu’il est vraiment : une fable. Autrement dit, un récit imaginaire selon lequel tout ce qui doit se produire d’une manière particulière pour atteindre le résultat souhaité se produit exactement comme souhaité. La seule « preuve » disponible est qu’il est possible d’imaginer une voie évolutive pour l’œil, mais en ignorant des détails essentiels. Une fois ces détails pris en compte, le fantasme commence rapidement à s’estomper, comme tous les fantasmes.
L’imagination n’est pas une preuve. Elle ne peut pas nous dire si les événements imaginés se sont réellement produits, ni même s’ils sont possibles. Or, tout porte à croire que ce n’est pas le cas.6
Des moments d’honnêteté
Lorsque leur public se restreint, les évolutionnistes sont souvent beaucoup plus directs les uns envers les autres. Dans leur article de 2006 pour la New York Review of Books, les auteurs Israël Rosenfield et Edward Ziff, favorables à la théorie de l’évolution, ont écrit :
« La faiblesse de la théorie darwinienne – dont se sont emparés les critiques laïcs de la théorie évolutionniste – est son incapacité à expliquer comment le gène détermine les caractéristiques observables de l’organisme. D’un point de vue évolutionniste, comment des organes complexes tels que les yeux, les bras ou les ailes peuvent-ils évoluer sur de longues périodes ? Qu’en est-il des formes intermédiaires ? »7
Rosenfield et Ziff admettent que la théorie de l’évolution ne parvient pas à expliquer le développement d’organes complexes. Ils poursuivent :
« En ce qui concerne l’œil humain, par exemple : comment est-il possible que les différentes parties d’un œil évoluent simultanément – le cristallin, l’iris, la rétine, ainsi que les vaisseaux sanguins nécessaires à l’alimentation de l’œil en oxygène et en nutriments, puis les nerfs qui doivent recevoir les signaux de la rétine et les envoyer aux muscles de l’œil ? Ces systèmes nerveux et vasculaires précis pourraient-ils être créés par des changements aléatoires graduels dans les gènes sur de longues périodes, comme Darwin l’a prétendu ? »8
Ils soulignent ensuite que les mêmes préoccupations s’appliquent à l’évolution des organes complexes en général : la nécessité de faire évoluer non seulement « des bras, des jambes et des yeux qui fonctionnent », mais aussi l’ensemble des systèmes intégrés nécessaires à leur fonctionnement, tels que les os et les muscles, les réseaux vasculaires transportant le sang et les systèmes nerveux communiquant des signaux.
Les défis systémiques soulignés par Rosenfield et Ziff correspondent exactement aux situations complexes ignorées dans les fables sur l’évolution des organes, comme nous l’avons noté plus haut.9
La réponse à ces questions est tout aussi vague qu’à l’époque de Darwin. Si aucune réponse n’est connue, si tout ce dont nous disposons sont des histoires à présenter comme des preuves, alors comment tant de personnes intelligentes peuvent-elles être aussi convaincues ? Comment tant de gens peuvent-ils considérer qu’un récit imaginaire, sans aucune preuve claire que cela se soit produit ni même que cela puisse se produire, soit une preuve suffisante pour déclarer que l’évolution de l’œil est un fait absolu ?
Un frisson bien justifié
Dans une lettre adressée à son ami Asa Gray, botaniste à Harvard, Charles Darwin résuma avec concision ses craintes et ses espoirs concernant sa théorie à propos de l’organe merveilleux qu’est l’œil : « Jusqu’à ce jour, l’œil me donne un frisson froid, mais lorsque je pense aux fines gradations connues, ma raison me dit que je devrais vaincre ce frisson froid. »10
Pourtant, après 160 ans de recherche, depuis que Darwin exprima ses inquiétudes au sujet d’organes tels que l’œil, de nombreux scientifiques favorables à l’évolution expriment les mêmes inquiétudes dans leurs moments d’honnêteté.
Il semble que son instinct de frissonner ait été le bon.
Personne ne peut raisonnablement prétendre que ces histoires sans fondement constituent des preuves suffisantes pour déclarer que l’évolution est un « fait ». Elles sont une preuve pour l’évolution au même titre qu’un personnage vêtu de rouge et descendant dans une cheminée est une preuve de l’origine des cadeaux de Noël.
Cependant, la preuve du statut de l’évolution en tant que « fait » de la nature est peut-être plus profonde que la chair et les os dont nous avons parlé jusqu’à présent. Des années après la publication de la théorie de Charles Darwin, les mécanismes moléculaires de la génétique ont été découverts et notre vision de sa théorie (et de la vie) n’a plus jamais été la même. Dans notre évaluation de l’affirmation centrale de l’évolution, tournons-nous à présent vers le domaine où l’évolution pourrait vraiment se produire, dans l’éventualité où elle existe : le domaine microscopique de la cellule.
Chapitre 4
L’univers de la cellule
La science moderne a accès à des domaines de la vie que les biologistes de l’époque de Darwin pouvaient seulement imaginer en rêve. La cellule vivante individuelle, la plus petite unité de vie, s’est désormais ouverte à nous. Depuis les organismes unicellulaires, comme les bactéries, jusqu’aux êtres vivants composés de milliards de cellules différentes, comme les êtres humains, les mécanismes de la vie dans ces mondes microscopiques sont la clé de la compréhension des phénomènes que Charles Darwin cherchait à expliquer.
Si l’évolution existe, alors elle doit avoir lieu dans le monde biochimique à l’intérieur de la cellule. L’identité et la nature même d’un organisme proviennent des processus qui se déroulent à l’intérieur de ses cellules. Pour qu’une créature produise quelque chose d’innovant (une nouvelle variation aléatoire que la sélection naturelle peut “récompenser”, en créant éventuellement des ailes, des yeux ou des poumons et en faisant progresser l’évolution), l’origine de ce changement doit se situer à l’intérieur de la cellule.
Comment se construit la vie ?
Nous ne disposons pas de l’espace nécessaire pour offrir une description détaillée du fonctionnement interne et moléculaire de la cellule, mais nous pouvons proposer un résumé qui suffira pour nos besoins. Les composants qui nous intéressent sont les suivants : les protéines, l’ADN et l’ARN.
Les protéines : ces molécules souvent massives sont les bêtes de somme de la cellule. Elles sont composées de sous-unités plus petites, 20 composés moléculaires appelés acides aminés. Ces acides aminés sont assemblés en longues chaînes, de la même manière que les 26 lettres de l’alphabet français sont assemblées en mots spécifiques, sauf que les chaînes d’acides aminés peuvent être beaucoup plus longues que n’importe quel mot dans quelque langue que ce soit. La plus grande protéine humaine, la titine, est une séquence d’environ 30.000 acides aminés, tandis que la protéine humaine la plus courante, le collagène, est formée d’une chaîne d’environ 1050 acides aminés.
Lorsque ces séquences d’acides aminés sont assemblées dans la cellule, elles se plient et se tordent à la manière d’un origami pour prendre des formes spécifiques et complexes. Ces formes confèrent aux différents types de protéines leur capacité fonctionnelle à agir comme des robots virtuels qui peuvent couper, déplacer, remodeler, capturer, examiner et assembler d’autres molécules, y compris d’autres protéines. Certaines protéines accomplissent peu de choses seules, mais elles travaillent avec d’autres protéines pour accomplir des tâches plus importantes, en tant que système complexe unifié.
Les plans de ces merveilles moléculaires sont stockés dans l’ADN.
L’ADN : abréviation d’acide désoxyribonucléique, l’ADN est le matériel génétique qui sert de plan pour la construction de toutes les protéines d’un organisme ; autrement dit, il contient les instructions pour vous construire.
L’ADN est une molécule étonnamment élégante et ingénieuse, ressemblant un peu à une échelle en colimaçon, dont les barreaux sont composés de sucres et de phosphates. Les échelons qui relient les côtés sont appelés bases azotées (ou paires de bases) : soit une paire d’adénine (A) et de thymine (T), soit une paire de cytosine (C) et de guanine (G). Ainsi, en se déplaçant le long d’un côté d’une molécule d’ADN, on rencontre une séquence de ces quatre bases.
Tout comme une séquence de 1 et de 0 d’un code informatique stocke les informations nécessaires à la programmation de l’ordinateur, la séquence des bases A, C, G et T dans le brin d’ADN est le code qui stocke les informations biologiques de la cellule. Dans le cas de l’ADN, la séquence code l’information pour les différents acides aminés utilisés pour construire les protéines. Par exemple, en code informatique ASCII binaire, la séquence 01100011 01101000 01100001 01110100 code le mot français « chat ». De même, dans l’ADN, la séquence CAGAAGCCA code les informations nécessaires à la machinerie cellulaire pour produire la chaîne d’acides aminés glutamine-lysine-proline.
Toutes les protéines sont construites sur la base des modèles codés dans l’ADN. Les processus biochimiques qui lisent et manipulent l’ADN relèvent donc du traitement de l’information, à l’instar des logiciels informatiques. Comme l’explique le chimiste biophysicien Peter Wills, « l’informatique biologique moléculaire basée sur l’ADN contrôle pour ainsi dire, voire “dirige”, toute la panoplie des événements biochimiques qui se produisent dans les cellules ».1
Le code de l’ADN est souvent appelé « information génétique » et les parties du brin d’ADN qui codent les informations à des fins particulières sont appelées « gènes ». Les gènes individuels constituent les unités fondamentales de programmation des fonctions biologiques et leur longueur peut varier considérablement. Par exemple, les gènes humains individuels intégrés dans l’ADN peuvent avoir une taille comprise entre 1000 et 38.000 bases azotées.2 Les informations stockées dans plusieurs gènes sont souvent utilisées conjointement pour construire une structure. Par exemple, l’œil humain nécessite l’utilisation d’au moins 94 gènes différents.3
L’ARN : abréviation d’acide ribonucléique, l’ARN est capable de transporter les mêmes informations que l’ADN. En bref, l’ARN est utilisé pour transmettre les instructions de construction des protéines contenues dans l’ADN, en les copiant et en les transportant au dehors du noyau, où l’appareil moléculaire attend d’assembler de nouvelles protéines.4
Ce processus, au cours duquel l’information stockée dans l’ADN est copiée par l’ARN puis utilisée pour assembler les protéines, est appelé le « dogme central » de la biologie moléculaire. Il est attribué à Francis Crick, un des codécouvreurs de la structure de l’ADN.
C’est l’information codée dans l’ADN qui est utilisée pour fabriquer les protéines qui construisent les organismes, qui vous construisent, et c’est l’information codée dans l’ADN qui est transmise des parents vers les enfants.5 C’est ainsi que la vie fonctionne et qu’elle se perpétue de génération en génération. Avec une compréhension de base de ce système étonnant, nous sommes prêts à répondre à la question qui nous occupe : ce que nous avons appris sur la vie au niveau le plus élémentaire démontre-t-il que l’affirmation centrale de l’évolution, c’est-à-dire que les bactéries peuvent devenir des baleines bleues, est bien un « fait » ?
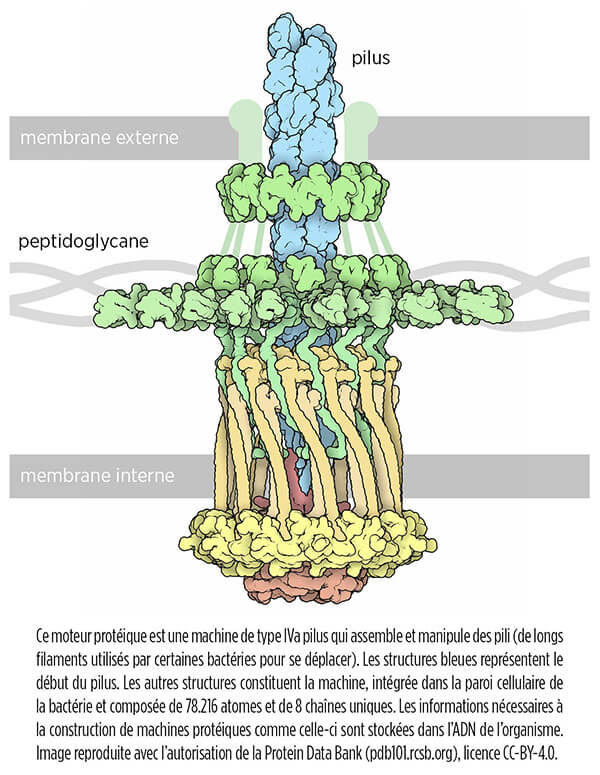
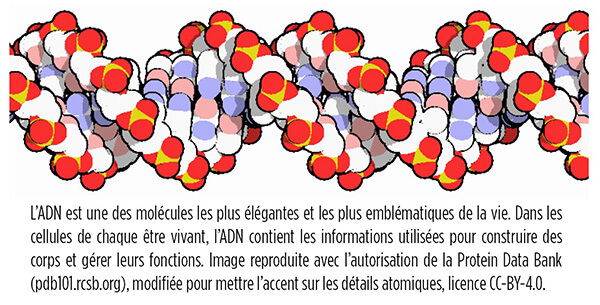
Du flou au concret
Certes, une grande partie du flou qui a dominé notre discussion sur l’évolution jusqu’à présent devient très spécifique lorsque nous arrivons au niveau de la génétique.
En examinant la cellule, nous constatons que les « variations aléatoires » de Darwin signifient que l’information utilisée pour construire l’organisme a changé, autrement dit que l’ADN a changé. En effet, l’ADN subit de nombreux changements aléatoires. Si, dans l’ensemble, la machinerie protéique dont dispose la cellule pour corriger les erreurs de copie de l’ADN est remarquable (en moyenne, un seul changement sur cent millions de nucléotides pour chaque génération de la cellule)6, nous savons également que des erreurs se produisent. Les nucléotides (les 1 et les 0 du code ADN : A, C, G et T) sont parfois mal copiés, les gènes sont dupliqués davantage qu’ils ne devraient l’être, des bouts de code sont accidentellement insérés à de nouveaux endroits. Les erreurs peuvent survenir de bien des manières.
La possibilité d’observer des variations aléatoires est une bonne nouvelle pour l’évolution, car c’est ce caractère aléatoire qui est à la base même de l’évolution et non la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que la sélection naturelle ne peut faire que ce que son nom suggère : sélectionner. Elle ne peut pas créer des innovations ou des changements. La sélection naturelle peut seulement « récompenser » ou « punir » les innovations générées par le hasard.
Comme l’a résumé le biologiste évolutionniste Andreas Wagner, « le pouvoir de la sélection naturelle est incontestable, mais il a des limites. La sélection naturelle peut préserver les innovations, mais elle ne peut pas les créer. »7
Avec cette connaissance, les histoires « floues » des possibilités de l’évolution se précisent. Par exemple, le scénario de l’évolution de l’œil n’est plus une sorte de « lentille » qui commence lentement à se « former », mais un ADN qui subit des changements aléatoires dans son code de sorte qu’il commence à concevoir de nouvelles protéines pouvant agir comme composants de la lentille.
L’ADN représente une information. Le langage de cette information (le code des acides aminés) est compris et la structure des protéines créées à partir de cette information peut être analysée. Cela signifie que nous nous trouvons aujourd’hui à un moment de l’histoire de la science où les possibilités et les limites de l’évolution (ses probabilités et ses vraisemblances) peuvent être calculées avec un bon degré de précision.
Lorsque nous soumettons les possibilités de l’évolution à ce niveau d’examen, nous constatons que les implications pour l’affirmation centrale ne sont pas bonnes.
Succès et limites de l’évolution
Dans une certaine mesure, nous constatons que l’évolution darwinienne peut se produire et elle a effectivement lieu. Par exemple, des mécanismes darwiniens ont été observés dans l’expérience d’évolution la plus longue de l’Histoire : l’expérience d’évolution à long terme (LTEE) du biologiste Richard Lenski avec la bactérie E. coli. Cette expérience s’est déroulée sans interruption depuis 1988 et a fini par produire une culture de bactéries qui a acquis la capacité de métaboliser le citrate lorsqu’un certain gène, normalement désactivé dans ces conditions, a été activé.8
Cependant, tous les succès connus et vérifiables de l’évolution mettent également en lumière ses limites. Par exemple, la modeste amélioration de la bactérie du Dr Lenski a nécessité près de 20 ans et 31.500 générations de bactéries9 (l’équivalent de 600.000 à 1.000.000 d’années pour l’homme), alors qu’elle n’a généré aucune information ou fonctionnalité véritablement nouvelle. Il s’agit avant tout d’une simple réaffectation et d’un redéploiement d’informations qui existaient déjà dans le génome.
Des études ont montré que de tels changements dans l’ADN (la destruction d’informations ou la réaffectation de structures pour lesquelles la cellule possède déjà des informations) sont, de loin, les principaux moyens par lesquels l’évolution agit.10 Afin de revendiquer le titre de « créateur de toute vie sur Terre », il ne suffit pas de réarranger des choses déjà existantes ou de les briser de manière à ce qu’elles ne puissent plus être utilisées.
Construire une baleine bleue à partir d’une bactérie nécessite l’ajout d’une grande quantité d’informations nouvelles à l’ADN de la créature. Il ne suffit pas de briser et de réorganiser les choses pour y parvenir. Il faut en créer de nouvelles.
Comme nous l’avons vu, cela implique la création de nouvelles protéines. Or, tout ce que nous avons appris sur la manière dont ces merveilleuses machines de la cellule sont construites montre que ce n’est pas une tâche simple.
Tentative n°1 :
fabriquer une nouvelle protéine à partir de rien
Si c’est le hasard qui crée et innove dans la cellule et que la sélection naturelle ne récompense l’innovation gagnante qu’en lui donnant la possibilité de se modifier davantage, nous devons d’abord nous poser la question suivante : le hasard peut-il générer des protéines entièrement nouvelles ?
D’un point de vue mathématique, la réponse est négative. Le biochimiste Manfred Eiger, lauréat du prix Nobel de chimie en 1967 et spécialiste respecté dans le domaine de la compréhension des grandes molécules et de l’évolution, a déclaré catégoriquement : « Pas même une seule molécule protéique avec une structure (et une fonction) spécifique ne pourrait se former par hasard. »11 Sa conclusion est qu’une protéine de taille très modeste, comprenant seulement 100 acides aminés, n’aurait qu’une probabilité de 1 sur 10130 de se former par hasard.
Si vous vous souvenez de vos années d’école secondaire, la notation exponentielle nous permet d’écrire de manière concise des nombres qui, autrement, seraient gigantesques. Dans le cas présent, 10130 s’écrirait sous la forme d’un 1 suivi de 130 zéros. Songez que les estimations du nombre d’atomes dans l’Univers entier tournent autour de 1080 (un 1 suivi de 80 zéros). Bien que 1080 soit déjà gigantesque, ce n’est presque rien comparé à 10130. Nous pouvons être certains qu’aucun événement d’une probabilité aussi faible ne s’est jamais produit dans l’Univers entier depuis son commencement.
Ce n’est pas une bonne méthode pour fabriquer un œil. Examinant comment une seule protéine, l’opsine, aurait pu se former par hasard de cette manière, Andreas Wagner a noté cette impossibilité : « Si un trillion d’organismes différents avaient essayé une chaîne d’acides aminés à chaque seconde depuis que la vie a commencé, ils n’auraient testé qu’une infime fraction des 10130 chaînes potentielles. Ils n’auraient jamais trouvé la seule chaîne de l’opsine. Il y a beaucoup de façons différentes d’arranger les molécules. Mais il n’y a pas assez de temps. »12
Même si nous ne cherchons pas à ce qu’une protéine spécifique se forme par hasard, mais n’importe quelle protéine fonctionnelle, le problème semble impossible. Si les acides aminés s’assemblent aléatoirement, quelles sont les chances qu’ils puissent un jour former une protéine fonctionnelle capable d’effectuer au moins quelque chose ? Le biochimiste Douglas Axe a exploré expérimentalement cette possibilité pour déterminer que la probabilité d’assembler aléatoirement une protéine fonctionnelle est seulement de 1 sur 1064 (un 1 suivi de 64 zéros). Une fois encore, il s’agit d’une probabilité extrêmement basse.13
La conclusion d’Eiger est solide comme le roc. Il est impossible qu’une protéine puisse un jour se former par pur hasard.
Tentative n°2 :
fabriquer une nouvelle protéine à partir d’une existante
De nombreux évolutionnistes pourraient, à juste titre, s’opposer à tout cela, affirmant qu’une approche darwinienne ne consisterait pas à construire une protéine entière à partir de rien. En revanche, l’évolution pourrait peut-être construire une nouvelle protéine à partir d’une existante. Il suffit de laisser l’ancienne protéine subir des mutations aléatoires et, comme la vie le fait avec les organismes entiers, les mauvais changements apportés à la protéine ne survivront pas, tandis que les bons changements apportés à la protéine (par exemple, en devenant plus stable, en accomplissant sa tâche plus efficacement ou en accomplissant une nouvelle tâche) seront préservés par la sélection naturelle.
Douglas Axe et sa collègue Ann Gauger ont cherché à explorer cette possibilité en termes concrets en prenant une protéine fonctionnelle et en examinant la probabilité que, par le biais de minuscules changements aléatoires semblables à l’évolution, elle puisse se transformer en une protéine similaire, mais légèrement différente. Ils ont choisi une protéine qui ne nécessitait que sept modifications nucléotidiques dans un brin d’ADN (comme si nous changions seulement sept 1 et 0 dans un programme informatique) pour accomplir la petite étape « évolutive ». Ils ont découvert qu’avec les taux connus de mutations aléatoires, il faudrait 1027 ans (un 1 suivi de 27 zéros) pour qu’un tel changement se réalise.14 Comparez cela avec le fait que l’Univers a seulement 1010 ans (environ 14 milliards d’années). Là encore, la probabilité qu’un tel événement se produise ne serait-ce qu’une seule fois dans notre Univers est nulle.
Ces résultats expérimentaux ont été observés dans la pratique, mais les méthodes évolutionnistes ont atteint leurs limites dans les laboratoires de génétique.
Par exemple, le bioingénieur finlandais Matti Leisola a utilisé les principes qui sous-tendent l’évolution (la sélection naturelle agissant sur des variations aléatoires) pour modifier des bactéries afin qu’elles produisent un substitut du sucre, le xylitol.15 Son équipe y est parvenue en accélérant les taux de mutation (c’est-à-dire les taux auxquels les variations aléatoires se produisent) en bombardant les bactéries avec des rayons UV. Comme prévu, la plupart des mutations ont été nocives, mais une mutation a permis d’obtenir ce que l’équipe souhaitait et la culture de cette bactérie a été conservée (ce qui équivaut à la sélection naturelle).
Cependant, la mutation a produit l’effet désiré en faisant ce que les mutations font si souvent : en interrompant un processus existant et non en générant de nouvelles informations.16
Il s’agit d’un modèle constant dans les travaux biologiques tels que ceux de Leisola. La mutation et la sélection aléatoires peuvent être utilisées pour réaliser des changements simples qui impliquent la rupture ou la destruction de processus déjà existants, voire l’affinement de ces processus par de petits changements. Mais lorsqu’une véritable innovation est nécessaire, aussi modeste soit-elle, elle est totalement hors de portée des méthodes évolutionnistes. L’évolution a des limites très claires.
Comme Leisola l’a résumé, « les protéines peuvent être modifiées par des méthodes aléatoires et spécifiquement conçues, mais seulement dans des limites étroites : les changements ne sont pas fondamentaux – les structures de base ne peuvent pas être modifiées »17 (c’est nous qui accentuons).
Bien entendu, même si ce problème était résolu, nous resterions confrontés au problème initial : pour qu’un processus puisse créer de nouvelles protéines à partir d’anciennes, il faut d’abord que ces anciennes protéines existent. Et comme nous l’avons déjà vu dans la « tentative n°1 », les chances de voir se former aléatoirement ne serait-ce qu’une seule protéine fonctionnelle dans l’histoire de l’Univers sont infinitésimales.
Le dogme selon lequel le darwinisme est capable de créer l’abondante diversité de vie que nous voyons autour de nous, à partir de formes beaucoup plus simples, persiste en tant que philosophie dominante de la biologie car aucune autre théorie ne possède un début de cohérence pour la remplacer.
Comme le fit remarquer David Berlinski, dans son style habituel et inimitable, « ce n’est pas parce qu’un orchestre, ou une explication, est le seul à jouer en ville qu’il en devient bon ».18
Les preuves d’une conception
Lorsque nous ouvrons la cellule, nous voyons un monde dans lequel l’évolution ne peut pas réaliser les choses mêmes qui doivent être accomplies pour que la théorie soit vraie. Le monde qui nous entoure montre que c’est tout le contraire qui a eu lieu. Nous voyons un monde rempli de preuves de complexité, de planification et de finalité. Des personnes raisonnables concluraient que nous voyons un monde dans lequel un dessein intelligent a joué un rôle.
C’est la conclusion naturelle et intuitive qui s’impose lorsque nous réfléchissons à la machinerie sophistiquée et complexe de la cellule : elle a été conçue dans un but précis.
La question qui se pose est de savoir si cette conclusion doit être écartée pour faire place au « fait » d’une évolution non guidée, au moyen de forces purement naturelles. Les données de la biochimie moderne apportent des éclaircissements : l’intérieur de la cellule révèle des mécanismes, des solutions innovantes et des systèmes qui semblent bien au-delà de la portée d’un processus aveugle et non intelligent comme l’évolution. Loin de nous inciter à rejeter la conclusion d’une conception ou d’un dessein planifié, les preuves nous incitent plutôt à l’adopter.
Chapitre 5
Des montagnes et des lunes
Pour conclure cette partie de notre périple, rappelons-nous l’affirmation centrale de l’évolution : des forces aveugles, non intelligentes et purement naturelles auraient pris un organisme unicellulaire primitif et l’auraient transformé au fil du temps pour aboutir à la remarquable diversité de vie que nous observons aujourd’hui sur cette planète, dans toute sa complexité et ses différences resplendissantes. Nous sommes censés croire que les forces aveugles de la nature ont commencé avec rien de plus qu’une créature microscopique ressemblant à une bactérie et qu’à partir d’elle, elles ont créé les baleines bleues, les chauves-souris, les mûriers, les coléoptères, les barracudas et les êtres humains. En fait, nous devons considérer cela comme un fait établi, hors de portée de toute question ou de tout doute.
Cela semble impossible à première vue, mais les évolutionnistes nous disent que ce n’est pas impossible. Selon eux, c’est même inévitable ; il faut s’y attendre.
Dans son livre Escalader le mont Improbable, Richard Dawkins reconnaissait les grandes différences que nous observons entre des créatures telles que les bactéries et les baleines bleues. Il établit une métaphore pour nous aider à comprendre comment l’une est devenue l’autre. Cette métaphore nous demande d’imaginer une montagne, avec l’humble bactérie en bas et la magnifique baleine bleue au sommet. L’évolution n’est alors qu’un voyage du bas de la montagne vers le sommet. Dawkins explique que la manière dont la bactérie atteint la baleine bleue est identique à celle employée par un alpiniste pour atteindre le sommet d’une montagne : non pas au moyen d’un saut gigantesque, mais plutôt par une ascension lente et régulière. Centimètre par centimètre, au cours de millions et de milliards d’années, avec des pas minuscules, le sommet finit par être atteint. De la même manière, il nous est dit que la simple créature unicellulaire peut devenir l’énorme et complexe maître des océans en accumulant des millions de minuscules changements au cours de milliards d’années. Le sommet est atteint, nous dit-on, parce que le grimpeur n’a qu’à faire un petit pas à la fois.
La métaphore de Dawkins est belle et simple. Mais la réalité l’a rendue inerte et impuissante. Une belle histoire gâchée par les faits.
L’échec central
En dépit des succès remportés par la science évolutionniste, et malgré tous les processus que les biologistes évolutionnistes ont pu découvrir, ainsi que les programmes, philosophies et produits intéressants qui ont pu être influencés par la pensée évolutionniste, un fait essentiel demeure : l’affirmation centrale de la théorie de l’évolution n’a toujours pas été prouvée. Il n’a pas été établi que toutes les formes de vie descendent d’un ancêtre commun simple et unique.
Pis encore : il n’a pas été démontré qu’une telle transformation soit même possible. La situation a été bien résumée par le Dr David Berlinski :
« Une grande partie des preuves de l’évolution […] provient d’une extrapolation grandiose et non étayée. Le papillon de nuit change la couleur de ses ailes ; les bactéries développent une résistance aux médicaments. Pourquoi cela jouerait-il en faveur de la thèse selon laquelle les baleines dérivent des ongulés [mammifères à sabots] ou les hommes des poissons ? En progressant régulièrement vers le sommet d’une montagne, l’alpiniste darwinien […] ne peut que constater que certains endroits restent à jamais hors d’atteinte, comme la surface de la Lune, par exemple. L’argument darwinien de l’évolution par accrétion [un processus d’agglomération] ignore une étape cruciale, celle qui démontrerait que les structures biologiques complexes sont accessibles à un mécanisme darwinien, soit à partir des premiers principes, soit à partir d’une observation attentive, et qu’elles fonctionnent donc comme un sommet de montagne plutôt que comme la surface de la Lune. »1
Avec son style fleuri caractéristique, Berlinski note que la métaphore du « mont Improbable » de Dawkins fait trop de suppositions. Et si, pour les bactéries, des créatures complexes telles que les baleines bleues, les chauves-souris et les êtres humains se trouvaient sur la Lune et non au sommet de leur montagne ? Dans ce cas, quelle que soit la douceur de la pente de la montagne et l’habileté de l’alpiniste, la bactérie pleine d’espoir ne les atteindra jamais.
Comment savons-nous que l’affirmation centrale de l’évolution est possible, sans même parler du fait qu’elle se serait réellement produite ?
Le fait que des forces naturelles aveugles aient transformé les descendants d’une créature, avec suffisamment de temps, en une multitude de créatures extrêmement différentes et plus complexes est l’affirmation définitive de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle. Pourtant, non seulement il n’a pas été démontré que cela s’est effectivement produit, mais il n’a même pas été démontré que c’était possible. L’affirmation centrale de la théorie est aussi son principal échec.
Le Darwin des lacunes
Examinez les questions suivantes à la lumière des preuves réelles, à la lumière de ce qui a été démontré comme étant vrai.
Disposons-nous d’un récit naturaliste sur la manière dont l’hypothétique « première vie » serait apparue à partir de la matière inerte sur cette Terre ? Non. Pouvons-nous expliquer comment elle serait apparue ailleurs et aurait été apportée ici ? Non. Avons-nous une explication satisfaisante et empiriquement fondée de la raison pour laquelle, à de rares exceptions près, les archives fossiles semblent si décousues et si différentes de l’histoire des changements graduels et sans heurts que nous devrions observer selon l’évolution darwinienne ? Non.
Disposons-nous d’un mécanisme naturaliste, sans réflexion, qui se soit montré capable de produire au fil du temps des structures et des systèmes aussi complexes et intégrés que l’œil humain, le système immunitaire, le poumon aviaire ou les microscopiques machines protéiques complexes à l’intérieur de la cellule ? Encore une fois, non.
En revanche, nous avons une foi solide, partagée par un grand nombre de scientifiques, dans le fait que, d’une manière ou d’une autre, les idées de Darwin peuvent réellement combler tous ces gouffres.
Lorsque des croyants sont confrontés à des phénomènes qu’ils ne peuvent expliquer et déclarent que « Dieu a dû le faire », ils sont accusés de croire en un « Dieu des lacunes ». De même, il semble que les évolutionnistes aient leur propre foi en un « Darwin des lacunes ».
Leur foi est-elle davantage fondée sur des faits que la vôtre ? La question mérite d’être posée. Mais ne laissez personne vous convaincre que la science a tranché en faveur de Darwin. C’est loin d’être le cas. Et les preuves (ou plutôt l’absence de preuves) sont très claires.
La vision du monde contre les preuves
Puisque les preuves n’ont pas établi l’évolution comme un « fait », pourquoi est-elle si passionnément défendue par un si grand nombre de personnes ? Pourquoi est-elle acceptée comme un dogme de manière aussi inconditionnelle ? Qu’est-ce qui lie les partisans de l’évolution à cette théorie ?
Dans un commentaire souvent cité et remarquablement honnête, l’évolutionniste Richard Lewontin expliqua très clairement la vision du monde à l’œuvre.
« Notre empressement à accepter des affirmations scientifiques qui vont à l’encontre du bon sens est la clé de la compréhension de la véritable lutte entre la science et le surnaturel. Nous prenons le parti de la science malgré l’absurdité manifeste de certaines de ses constructions, malgré son incapacité à tenir un grand nombre de ses promesses extravagantes en matière de santé et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique à l’égard d’histoires sans fondement, parce que nous avons un engagement préalable, un engagement à l’égard du matérialisme. Ce n’est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent à accepter une explication matérielle du monde phénoménal, mais plutôt que notre adhésion a priori aux causes matérielles nous oblige à créer un appareil d’investigation et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles, même si elles sont contre-intuitives ou mystifiantes pour les non-initiés. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas laisser un pied divin dans la porte. »2
Nous ne prétendons pas que le Dr Lewontin serait d’accord avec notre conclusion, mais ses paroles la soutiennent solidement. Pourquoi les partisans de l’évolution s’accrochent-ils aux histoires sans fondement de l’évolution ? Pourquoi sont-ils prêts à s’engager si passionnément en faveur de l’évolution face à « l’absurdité manifeste de certaines de ses constructions » ?
Pour reprendre les termes de Lewontin, « ce n’est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent » à un engagement aussi zélé. Il s’agit plutôt d’un « engagement préalable, un engagement envers le matérialisme [et] ce matérialisme est absolu. »3 Il s’agit d’un choix conscient de la vision du monde.
Les évolutionnistes choisissent de voir le monde à leur manière. Et quand les preuves ne correspondent pas à leur vision, ils attendent aussi longtemps qu’il le faut, persuadés que les réponses finiront par arriver, guidés par la foi et non par les faits.
Une telle franchise de la part de Lewontin concernant ces présupposés métaphysiques devrait être la bienvenue. Elle devrait être la norme parmi les scientifiques et les non-scientifiques. Mais ce n’est pas le cas. C’est ainsi que nous entendons parler de « preuves irréfutables » sans mentionner la foi qui a été employée pour interpréter ces preuves, combler les lacunes de ces preuves et philosopher sur la signification de ces preuves. Pourtant, il est difficile de ne pas remarquer les parallèles entre la dévotion à l’évolution et la dévotion à Dieu. Quelle que soit la question, même lorsque les questions se contredisent, voyez comment la réponse des évolutionnistes est toujours « l’évolution ».
Quand les animaux changent au fil du temps, passant du simple au complexe ? C’est l’évolution. Et s’ils changent en sens inverse, de formes complexes vers des formes plus simples ? C’est aussi de l’évolution.
Si les animaux possèdent des organes ou des structures « inutiles » ? L’évolution les a rendus inutiles. Mais si les animaux possèdent des organes et des structures d’une grande complexité et d’une grande utilité ? C’est l’évolution qui les a construits.
Un organisme possède des processus biologiques remarquablement efficaces ? C’est le génie de l’évolution. Un autre organisme possède des processus biologiques inefficaces et « encombrants » ? L’évolution est aveugle et non dirigée.
Quand les animaux restent inchangés sur de vastes périodes ? L’évolution a préservé leurs formes. Mais lorsqu’on pense qu’ils ont changé à un rythme si rapide qu’ils ne laissent que peu de traces d’une quelconque transition ? Eh bien, l’évolution peut aussi aller très vite !
Nos capacités supérieures en matière de pensée rationnelle, d’art, de musique et de poésie ? L’évolution est étonnante. Nos caractéristiques les plus basiques, les plus « animales » ? L’évolution ne s’intéresse qu’à la survie.
Des caractéristiques uniques et extrêmes au sein d’une espèce ? C’est cette bonne vieille évolution. Des caractéristiques similaires chez des animaux très différents ? L’évolution converge souvent vers les mêmes caractéristiques.
Des changements dus à de petites mutations bénéfiques ? Bien entendu, puisque c’est ainsi que fonctionne l’évolution ! D’autres changements qui ne sont pas accessibles par des mutations bénéfiques accumulées ? L’évolution fonctionne parfois de manière mystérieuse…
Changer le nom de la divinité de « Dieu » par le terme « évolution » suffit-il à rendre quelque chose non religieux ? Cela suffit-il pour que votre foi ne soit plus une foi ?
Un résumé de ce que nous avons vu
Il est souvent présenté comme un « fait » que toute vie a progressivement évolué au fil du temps à partir d’un ancêtre unique et simple, mais les preuves ne justifient pas une telle conclusion. Oui, la vie semble capable de changer au fil du temps, mais la capacité de changer sans limite n’a jamais été démontrée.
Les archives fossiles ne confirment pas l’histoire espérée par Darwin d’un développement progressif de la vie sur Terre. Cela reste aussi troublant pour sa théorie aujourd’hui que pour lui en 1859. Non seulement les inquiétudes de Darwin concernant l’œil sont toujours aussi valables qu’il y a un siècle et demi, mais elles demeurent non résolues. Il n’a rien d’autre que des fables et des suppositions en guise de « preuves ». Lorsque nous concentrons notre attention sur le domaine où les changements fondamentaux et graduels exigés par l’évolution doivent avoir lieu (l’information et la machinerie de la cellule), nous constatons que le mot « invraisemblable » est encore trop généreux. L’histoire de l’évolution naturaliste et non guidée semble impossible.
Ce monde microscopique qui constitue le fondement de la vie est bien plus avancé et compliqué que Darwin n’aurait jamais pu le comprendre à son époque. Il révèle davantage un grand concepteur que des forces aveugles de la nature. Il révèle un concepteur qui a intelligemment créé la programmation de la vie dont dépend chaque organisme vivant sur Terre.
La théorie de Charles Darwin est, à sa manière, un exemple remarquable d’observation et de raisonnement, une théorie élégante avec de grandes aspirations et de grandes affirmations à propos du monde et de ce qu’il contient.
Il lui manque simplement la vertu d’être vraie.
Chapitre 6
La Terre est-elle jeune ? Comprendre Genèse 1
Après avoir examiné les affirmations extrêmes de l’évolution darwinienne, tournons-nous vers les affirmations extrêmes du créationnisme Jeune-Terre : l’affirmation selon laquelle la Bible enseignerait que la Terre (voire l’Univers et tout ce qu’il contient) a été créée par Dieu il y a seulement 6000 ans.
Nous avons examiné l’évolution sous l’angle de la science et avons constaté qu’elle n’était pas à la hauteur des affirmations proclamant qu’il s’agit d’un fait incontestable. Qu’en est-il des affirmations des créationnistes de la Jeune-Terre ? Dans quelle mesure sont-elles factuelles ? La perspective dans laquelle elles s’inscrivent est, sans aucun doute, très différente de celle des évolutionnistes.
Avant de poursuivre, il convient d’examiner cette différence de perspective.
Reconnaître certains mérites
Les évolutionnistes partent du principe du matérialisme naturaliste, une position exigeant que toute explication soit basée uniquement sur le domaine du monde matériel des causes naturelles. Le surnaturel ne peut être autorisé à occuper ne serait-ce qu’un rôle théorique, que ce rôle ait ou non un sens rationnel, d’où la position de Richard Lewontin que nous avons soulignée et reconnue pour son honnêteté au chapitre précédent.
Bien entendu, il existe d’autres visions du monde. Les créationnistes de la Jeune-Terre s’appuient sur l’une d’entre elles : la vision selon laquelle la Bible est inspirée par Dieu Lui-même et qu’elle est digne de confiance dans tout ce qu’elle dit. Cette observation est correcte, mais la révélation joue également un rôle. Elle joue même le rôle principal. Si Dieu dit qu’une chose est ainsi, alors c’est bien le cas. Dieu est tout-puissant et omniscient.
Cependant, même le fait de reconnaître que la Bible soit vraie dans toutes ses déclarations ne protège pas contre toutes les failles. L’une d’entre elles est la vulnérabilité d’une interprétation erronée. Même si la Bible est vraie, les êtres humains imparfaits que nous sommes peuvent toujours se tromper s’ils la comprennent mal. Dans ce chapitre, nous allons explorer cette possibilité en comparant avec la Bible les croyances des créationnistes de la Jeune-Terre, selon lesquelles l’Univers et tout ce qu’il contient, y compris la vie, auraient été créés à partir de rien il y a environ 6000 ans.
Mais avant cela, reconnaissons-leur certains mérites : le fait que la Bible soit considérée comme la parole inspirée et authentique de Dieu est tout à fait exact. L’engagement des créationnistes de la Jeune-Terre à l’égard du principe de la véracité biblique doit être salué.
L’apôtre Paul l’a bien exprimé : « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur » (Romains 3 :4). Si Dieu dit quelque chose, c’est vrai. Si des preuves semblent contredire Ses paroles, vous pouvez être certain(e) de deux choses : soit vous avez mal compris la Bible, soit vous avez mal compris les preuves.
Souvent, le fait d’adopter une position aussi ferme sur la parole de Dieu est raillé par les scientifiques athées qui qualifient cette attitude de « foi aveugle ».
Il est vrai que beaucoup de gens n’ont jamais cherché à prouver par eux-mêmes l’existence de Dieu ou la fiabilité de Sa parole. Si vous n’avez jamais cherché à savoir si Dieu existe ou non, ou si la Bible est bien Sa parole, vous devriez le faire.1
Une fois que vous avez prouvé l’existence de Dieu et le fait que la Bible soit Sa parole, ces certitudes deviennent des preuves fondamentales pour interpréter le monde qui nous entoure. Seul Dieu a toujours existé et, par conséquent, Lui seul est un témoin digne de confiance des événements qui ont précédé l’histoire de l’humanité.
Ken Ham, célèbre créationniste de la Jeune-Terre, a souligné cela au cours de son premier débat public avec Bill Nye, personnalité de la télévision « pro-science » : « J’admets que mon point de départ est que Dieu soit l’autorité absolue. Si quelqu’un n’accepte pas cela, alors c’est l’homme qui doit être l’autorité absolue. En fin de compte, c’est là toute la différence. »2
Ce principe est vrai et il faut féliciter Ham de l’avoir adopté.3 Comme Jésus-Christ l’a dit si clairement en priant Son Père, la nuit précédant Sa crucifixion : « Ta parole est la vérité » (Jean 17 :17).
Le monde témoigne-t-il des affirmations de la Jeune-Terre ?
Cependant, partir d’un principe juste et courageux ne garantit pas d’aboutir à des conclusions correctes. Dans un instant, nous nous pencherons sur ce que la Bible dit réellement au sujet de l’origine du monde et sur les implications de ses enseignements pour le créationnisme Jeune-Terre. Mais posons-nous d’abord la question suivante : les preuves physiques qui nous entourent confirment-elles une « Terre jeune » ?
En bref, la réponse est négative. Les efforts des créationnistes pour interpréter les données de la géologie, de l’astronomie, de la physique et des autres sciences en fonction de leur théorie sont admirables, mais peu convaincants.
L’affirmation selon laquelle Dieu aurait créé le monde avec une apparence d’âge et de maturité, tout comme Il a créé Adam et Ève comme des adultes et non des enfants, n’explique pas pourquoi la Terre présente non seulement un certain âge, mais aussi une histoire. Adam a été créé mature, mais il n’a pas été créé avec des cicatrices chirurgicales d’opérations passées, une dent ébréchée suite à une chute, ou une calcification sur un os de la jambe suite à une fracture. La Terre témoigne d’une longue histoire.
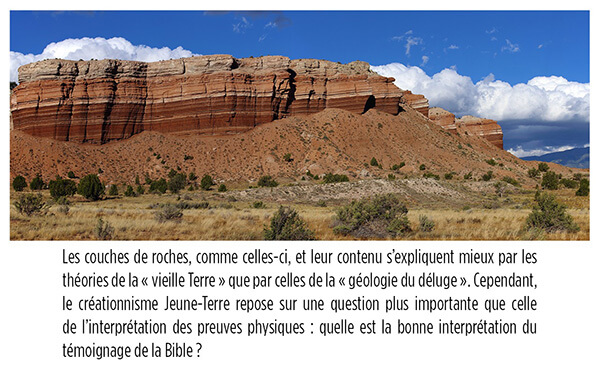
Les tentatives de faire entrer toute cette histoire dans 6000 ans, ou d’attribuer les signes de l’histoire aux effets du déluge de Noé, sont tout aussi problématiques. Par exemple, les couches de terre qui se trouvent sous nos pieds et leur contenu s’expliquent bien mieux par des théories qui admettent qu’elles se sont déposées au cours de vastes périodes que par l’idée qu’un seul déluge mondial a créé ces caractéristiques.4 Le fait de supposer que l’Univers a été créé il y a seulement 6000 ans ne fait qu’amplifier les problèmes de la Jeune-Terre, soit en représentant Dieu comme quelqu’un créant de fausses histoires d’événements astronomiques (des changements et des événements liés à des étoiles dont la première lueur, située à plus de 6000 années-lumière, ne nous serait même pas encore parvenue), soit en supposant des changements dans les lois de la physique qui causent plus de problèmes à la théorie qu’ils n’en résolvent.
Encore une fois, ce n’est pas la vraie question pour les défenseurs de la Jeune-Terre. Au fond, ils sont dans la même position que les évolutionnistes. Ils sont convaincus que leur théorie est vraie et ils supposent que les preuves, même lorsqu’elles ne correspondent pas encore, finiront par le faire. La seule différence est qu’ils considèrent la Bible comme leur principale preuve.
Ont-ils raison ? La Bible enseigne-t-elle que l’Univers, la Terre et la vie ont été créés il y a seulement 6000 ans ? Enseigne-t-elle autre chose ?
Dispenser droitement la parole de la vérité
Pour découvrir toute la vérité sur un sujet, selon la perspective biblique, il faut considérer l’ensemble de la parole de Dieu, du début à la fin. Comme l’a proclamé Ésaïe :
« À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là » (Ésaïe 28 :9-10).
Nous lisons encore : « Le fondement de ta parole est la vérité » (Psaume 119 :160). Nous devons la considérer dans sa totalité pour comprendre la vue d’ensemble de la pensée divine sur un sujet donné. Elle doit être examinée avec soin et diligence, avec une approche qui « dispense droitement la parole de la vérité » (2 Timothée 2 :15). N’appliquer qu’une partie de la Bible, ou mal l’appliquer, conduit à des conclusions inexactes (voir Marc 12 :18-24).
La parole de Dieu enseigne beaucoup de choses qui ne peuvent être comprises que par Sa révélation, des vérités hors de portée de la méthode scientifique, aussi utile soit-elle. Bien que la Bible ne réponde pas à toutes les questions que nous nous posons, lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, elle répond à bien plus de questions que beaucoup ne le pensent.
Et ses réponses sont toujours véritables. Bien que la Bible n’ait pas été écrite pour être un texte scientifique, son témoignage est cohérent avec les faits scientifiques à un degré que seul Dieu, le Créateur de la nature et le Témoin de l’histoire, peut garantir.
Regardons ce que Dieu a révélé au sujet de l’histoire du monde. Faisons-le avec un cœur guidé par l’humilité et un esprit ouvert à ce qu’Il déclare ! S’il y a une réponse à trouver concernant l’origine de la création, elle doit être révélée par le Créateur.
Comprendre Genèse 1 :1 et 1 :2
Le premier verset de la Bible est un des passages les plus célèbres de tous les écrits que l’humanité possède. Genèse 1 :1 dit : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Puissant dans sa simplicité, ce verset déclare sans équivoque que toute réalité (de la Terre sous nos pieds aux étoiles au-dessus de nous) est la création du Tout-Puissant ! Tout ce qui existe a été amené à l’existence sur l’ordre de Dieu.
Une fois que le rôle de Dieu dans la création de toutes choses est clairement énoncé, Genèse 1 :2 continue : « La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
Les mots « informe et vide » ont suscité de longues interrogations. Ils dérivent de deux mots hébreux, tohu (informe) et bohu (vide), qui peuvent être traduits de différentes manières. Tohu peut signifier une désolation, un désert ou une terre inculte, indiquant un état de confusion et de chaos. Il apparaît 20 fois dans les Écritures hébraïques et « dans la plupart de ces cas, sinon tous, tohu a un sens négatif ou péjoratif ».5 Le mot bohu n’apparaît qu’avec tohu, ajoutant un sens de vide et de ruine.
Indépendamment de la manière spécifique dont ces mots sont traduits, il devrait être clair qu’un état de tohu-bohu n’est pas agréable ! Mais comment comprendre ces mots ? Certains ont suggéré de les traduire par « non formée et non remplie »,6 avec une connotation très neutre, impliquant quelque chose d’équivalent à un morceau d’argile en attente d’être façonné en quelque chose d’utile par la main du Maître. Est-ce la bonne façon de comprendre les mots ?
L’emploi du verbe « être » n’aide pas à trancher dans un sens ou dans l’autre, laissant de nombreuses possibilités ouvertes. Dans la phrase « la terre était informe et vide », le mot hébreu traduit par la conjugaison « était » est hayah, qui autorise différentes interprétations. Par exemple, il est utilisé dans l’histoire de Lot fuyant Sodome avec sa femme et ses filles. Lorsque la femme de Lot regarda la destruction de Sodome et Gomorrhe, nous lisons : « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel » (Genèse 19 :26). Le mot traduit par « devint » est également hayah dans le texte original.
Il est clair que la femme de Lot ne fut pas toujours une statue de sel (ce qui aurait donné lieu à un mariage étrange). C’est plutôt à ce moment-là, après avoir regardé en arrière, qu’elle devint une statue de sel, mais elle ne l’était pas auparavant. C’est pourquoi les traducteurs de la Bible utilisent à juste titre le verbe « devenir » et non « être ». Grammaticalement, les deux verbes sont corrects, mais « devenir » implique une transformation ou un changement d’état vers une condition nouvelle.
Un verset difficile
En raison notamment de ces questions, le sens précis de Genèse 1 :2 a longtemps été débattu. Certains pensent que l’Univers tout entier a été créé le « premier jour de la semaine de la création » de la Genèse et que Dieu créa la Terre dans cet état chaotique et inorganisé, en attendant de la modeler et de la former, selon la description faite aux versets suivants. D’autres ont considéré que l’état de tohu-bohu de la Terre était un état préexistant au début des sept jours de la « semaine de la création », soulignant que la durée pendant laquelle la Terre a enduré cet état est ambiguë dans le texte.
Les érudits ne sont pas d’accord entre eux à propos de ce court verset, invoquant d’obscures règles grammaticales et cherchant à déterminer les temps. Ken Ham affirme que « le verset 2 utilise un procédé grammatical hébreu appelé “vav disjonctif” […] Cette conjonction indique que la phrase donne une description de la précédente ; elle ne la suit pas dans le temps. »7
D’autres traducteurs, comme ceux de la Bible vivante, adoptent des points de vue différents. Bien que cette traduction soit une paraphrase, ses notes de bas de page offrent un aperçu plus rigoureux des langues originales de la Bible. Cette version traduit Genèse 1 :2 par « la terre était une masse informe et chaotique », mais elle mentionne dans les notes de bas de page que d’autres traductions sont possibles pour ce verset : « La terre était ou “la terre devint” une masse informe et chaotique, ou “informe et vide” […] Il n’y a pas une seule façon correcte de traduire ces mots. »8
D’autres érudits ont des explications différentes. Richard Elliott Friedman, spécialiste des langues et des cultures du Proche-Orient ancien, diplômé de Harvard et du Séminaire théologique juif, a écrit dans son commentaire sur Genèse 1 :2 : « Dans l’hébreu, pour ce verset, le nom précède le verbe (à la forme parfaite). On sait aujourd’hui que l’hébreu biblique exprime le passé parfait de cette manière. » Cette construction grammaticale « signifie que “la terre avait été informe et difforme” » avant le début des sept jours de la création décrits dans le reste du texte.9
L’idée que le sens de Genèse 1 :2 va être indiscutablement élucidé par la lecture technique de la langue hébraïque est malheureusement infondée. L’Histoire ne nous aide pas davantage. Il existe des preuves historiques montrant que de nombreuses personnes ont considéré Genèse 1 :1-2 comme une description de l’activité du premier jour de la « semaine de la création », mais il existe aussi de nombreuses preuves que d’autres individus ont considéré Genèse 1 :2 comme un état dans lequel la Terre a existé pendant une certaine période, dont la durée est inconnue, avant la semaine de la création.
Par exemple, au début du 3ème siècle de notre ère, Origène, un des premiers théologiens de ce qui allait devenir l’Église catholique, écrivit dans son ouvrage Traité des principes que « les cieux et la terre que nous voyons » provenaient d’une création antérieure mentionnée dans Genèse 1 :1.10 Dans le Targum Onkelos, une importante traduction araméenne de la Torah (comprenant la Genèse), rédigé entre 80 et 120 av. J.-C., l’énoncé hébreu « tohu et bohu » de Genèse 1 :2 est traduit par tzadya ve-reikanya, une formulation araméenne qui décrit un sentiment de désolation, de ruine et de vide.11
De telles pensées ont perduré à travers le temps. Au début du 12ème siècle, Hugues de Saint-Victor déclarait à propos des premiers versets de la Genèse : « Il ressort de ces paroles qu’au commencement du temps, ou plutôt avec le temps lui-même, la matière originelle de toutes choses est venue à l’existence. Mais combien de temps est-elle restée dans cet état confus et informe ? L’Écriture ne nous le dit pas clairement. »12 Cinq siècles plus tard, Denys Pétau écrivait à propos de la Terre chaotique et en ruine décrite au verset 2 : « Combien de temps cet intervalle a-t-il pu durer ? Il est impossible de le deviner. »13
Il ne s’agit là que d’un échantillon d’opinions et d’interprétations, suffisant pour illustrer le fait que la date de la création originelle de la Terre et les conditions dans lesquelles elle se trouvait avant le premier jour de la « semaine de la création » de la Genèse sont une des questions qui restent ouvertes depuis assez longtemps. Il est erroné de prétendre que la seule interprétation de Genèse 1 :1-2 ayant une certaine crédibilité linguistique ou ancestrale est celle affirmant que l’Univers a été créé il y a seulement 6000 ans. En lisant ces versets en hébreu, beaucoup concluent qu’avant le premier jour, au cours duquel Dieu a dit « Que la lumière soit » (Genèse 1 :3), la Terre et l’Univers existaient déjà depuis un certain temps, mais qu’à un instant donné après cette création initiale, la Terre est entrée dans un état de tohu-bohu (de désolation et de ruine).
Cependant, le simple fait d’identifier des possibilités ne révèle pas la vérité à ce sujet. Comment faut-il comprendre les deux premiers versets de la Genèse ? Quand la Terre a-t-elle été créée ? Comment s’est-elle retrouvée dans un état de tohu-bohu ? En était-il ainsi à l’origine ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi se trouve-t-elle dans un tel état lorsque Dieu commence à façonner le monde au cours de la « semaine de la création » de la Genèse ?
Comme toujours lorsqu’il s’agit de signification et d’interprétation, la Bible fournit ses propres réponses ! Nous comprenons le sens de ce passage lorsque nous examinons d’autres versets décrivant la « préhistoire » de la Terre, ce qui permet à la Bible de s’interpréter elle-même.
Un monde tohu-bohu, mais pourquoi ?
Le monde a-t-il été créé dans un état de tohu et bohu ? Ces mots signifient-ils que le monde a été créé « non formé » et « non rempli », dans l’attente de la poursuite de l’œuvre de Dieu ? Ou signifient-ils que le monde était devenu « dévasté » et « en ruine », un monde qui aurait été amené à la destruction ?
Beaucoup ont noté Ésaïe 45 :18. En parlant de la Terre, ce verset déclare que Dieu « l’a créée pour qu’elle ne soit pas déserte [tohu] » ou comme le traduit la Bible de Jérusalem : « C’est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et l’a faite […] il ne l’a pas créée vide [tohu]. » Cela laisse à penser qu’à l’origine Dieu ne créa pas le monde dans un état de confusion et de désolation, mais que celui-ci fut soumis à cet état par la suite. Or, certains soutiennent que le verbe « créer » dans ce passage devrait être compris comme se référant au produit final de la Terre achevée. D’autres passages pourraient-ils clarifier le sens de ces mots ?
Absolument. La Bible nous donne d’autres exemples employant le tohu-bohu décrit dans Genèse 1 :2. Les implications sont très claires dans ces passages.
Dans Jérémie 4, le prophète déplora la nature pécheresse du peuple et sa rébellion dépravée contre son Créateur (versets 14-17). Le peuple fut alors informé que ses péchés entraîneraient des conséquences (verset 18).
Ces conséquences étaient une dévastation totale. Jérémie décrivit avec angoisse les armées qui descendraient sur Jérusalem, entraînant la désolation dans leur sillage : « On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé ; mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant » (verset 20). Dieu constata que les habitants de Son peuple « sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien » (verset 22). Quel fut le résultat final du péché et de la dépravation du peuple ? Voici la description faite par Jérémie :
« Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ; et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert ; et toutes ses villes sont détruites, devant l’Éternel, devant son ardente colère » (Jérémie 4 :23-26).
L’expression « informe et vide » au début de ce passage est la paire tohu et bohu, comme dans la Genèse. Ici, il est très clair que ces mots sont utilisés pour décrire la dévastation totale causée par le péché.
Ce passage n’est pas le seul. La troisième et dernière utilisation de la paire tohu et bohu se trouve dans Ésaïe 34. Dans ce chapitre, un avertissement est adressé à toute la création (verset 1), puis des scènes de désolation et de ruine totales provoquées par le péché sont décrites, notamment des massacres, des ruisseaux transformés en poix et de la poussière transformée en soufre (versets 2-9).
Puis le prophète expliqua ce que Dieu allait faire au travers de cette destruction : « On y étendra le cordeau de la désolation, et le niveau de la destruction » (verset 11). La langue hébraïque révèle ici une vérité qui n’est pas visible dans les traductions : les mots traduits par « désolation » et « destruction » sont respectivement tohu et bohu dans le texte original.
Ces deux passages limpides de la parole de Dieu établissent incontestablement un lien entre le tohu-bohu et un état de désolation, de dévastation et de destruction qui s’abat sur la Terre suite aux conséquences du péché. Mais comment se fait-il que Genèse 1 :2 décrive la Terre dans un état faisant suite au péché ? Puisque Adam et Ève, les premiers êtres humains, ne furent créés qu’au sixième jour de la « semaine de la création » de la Genèse, comment le péché aurait-il pu exister avant le premier jour de cette semaine ?
Dans la création physique, seule l’humanité est capable de pécher, c’est-à-dire de commettre l’acte moralement coupable de défier notre Créateur. Les plantes ne pèchent pas. Les animaux ne pèchent pas. Lorsqu’un lion tue, il ne devient pas un meurtrier. Il est seulement affamé !
Si un état de tohu-bohu (de dévastation et de destruction) est apparu avant la « semaine de la création » suite aux conséquences du péché, nous devons alors nous poser la question suivante : existait-il des entités moralement responsables, intelligentes et dotées du libre arbitre avant la période décrite dans la Genèse 1 :2 ?
La réponse catégorique de la Bible est « oui ». Le monde angélique existait avant la Terre. Son rôle dans l’histoire de la création est fascinant et éclairant. Nous allons à présent examiner ce que la Bible nous apprend à ce sujet.
Chapitre 7
La rébellion, la ruine et la restauration
Lorsque nous considérons l’histoire de tout ce qui a été créé, nous devons tenir compte des anges. La parole de Dieu révèle que ces entités spirituelles sont des êtres créés. Pour l’instant, ils sont supérieurs à l’humanité, mais ils la servent par leur travail. Ils sont finalement destinés à être sous notre autorité lorsque le plan de Dieu sera achevé (Hébreux 1 :7, 14 ; 2 :7 ; 1 Corinthiens 6 :3).
La Bible indique clairement que ces êtres ont été créés avant que notre planète n’existe. Lorsque Dieu commença à se révéler et à dévoiler Sa puissance au patriarche Job, Il l’interpella au sujet des débuts de la Terre, en lui demandant dans Job 38 :4-7 :
« Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? […] Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? »
Bien que l’expression « fils de Dieu » soit utilisée de multiples façons dans les Écritures pour désigner à la fois les anges et les hommes, elle est réservée exclusivement aux anges dans le livre de Job (voir Job 1 :6 ; 2 :1). La référence aux « étoiles du matin » clarifie encore davantage cette déclaration. (Apocalypse 12 :4 utilise également des étoiles pour symboliser les anges.)
Lors de la pose des fondations et de la « pierre angulaire » initiale (le tout début de la création de la Terre), nous constatons que les anges existaient déjà puisqu’ils poussèrent des cris de joie à cette occasion ! Les Écritures démontrent clairement que les anges existaient avant que les fondations mêmes de la Terre existent.
Elles enseignent clairement qu’il s’agit d’individus moralement responsables et dotés d’un libre arbitre. Elles affirment sans ambiguïté qu’à un moment indéterminé, dans un passé lointain, certains de ces anges ont péché et se sont rebellés contre leur Créateur.
Le péché de Heylel (Lucifer)
Les prophéties d’Ézéchiel 28 et d’Ésaïe 14 concernent directement des êtres humains, mais elles font toutes deux référence à une puissance angélique qui agit derrière les trônes des hommes. Dans ces deux brefs aperçus, elles racontent l’histoire d’une chute tragique, où la justice fit place à l’iniquité.
En parlant du « prince », puis du « roi » de Tyr (comparez les versets 2 et 12 d’Ézéchiel 28), le prophète décrivit clairement un individu bien plus grand que le dirigeant physique et humain de cet ancien pays :
« Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi » (Ézéchiel 28 :14-15).
Cet être angélique, auparavant « plein de sagesse, parfait en beauté » (verset 12), resplendissant et rempli de créativité depuis le moment où il fut créé (verset 13), a péché et s’est rempli de violence. Devenu sacrilège et corrompu, il fut alors précipité « de la montagne de Dieu » (verset 16).
Que s’est-il passé ? Quelle est l’iniquité qui remplissait et polluait ce puissant chérubin ? La prophétie d’Ésaïe nous donne plus de détails, y compris le nom de ce chérubin : Lucifer.
« Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles [des anges] de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut » (Ésaïe 14 :12-14).
La version Ostervald traduit ainsi le début du verset 12 : « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore ? » Le nom « Lucifer » est emprunté à la Vulgate, la traduction latine la plus populaire de la Bible. Il s’agit de la traduction en latin du mot hébreu Heylel, signifiant « porteur de lumière » ou « astre brillant ». Ce chérubin, Heylel, chercha à être plus puissant que son Créateur, le « Très-Haut » ! Ce passage décrit l’origine de Satan le diable, que Jésus dit avoir vu « tomber du ciel comme un éclair » (Luc 10 :18). Après sa défaite, ce chérubin n’était plus Heylel ou Lucifer, il devint Satan, un mot qui signifie « adversaire ».
Apocalypse 12 :4 semble indiquer que Lucifer, devenu Satan, a convaincu un tiers des anges de le suivre dans sa rébellion. Cette ascension funeste au ciel contre le Créateur explique d’autres passages faisant référence aux « anges qui ont péché » (2 Pierre 2 :4) et aux « anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure » (Jude 1 :6).
Où était-il auparavant ?
La description qu’Ésaïe fit de cette rébellion angélique contient des détails fascinants qui passent souvent inaperçus. Notez par exemple que Lucifer a dit : « Je monterai au ciel » et « Je monterai sur le sommet des nues » (Ésaïe 14 :13-14).
Pour monter « sur le sommet des nues » (au-dessus des nuages), il faut au préalable être en dessous des nuages ! Avant sa rébellion, Satan le diable était sous les nuages et sur la Terre. Dans les Écritures, cette association entre le diable et la Terre est significative. Elle apparaît ainsi dans Job 1 :7 et Job 2 :2, où Satan parle du temps qu’il passa sur la Terre. Le Sauveur Lui-même, Jésus-Christ, qualifia Satan de « prince de ce monde » à trois reprises dans les Écritures (Jean 12 :31 ; 14 :30 ; 16 :11).
Satan lui-même expliqua pourquoi il possède une telle autorité sur la Terre. Alors qu’il tentait le Christ dans le désert, au début de Son ministère, le diable montra à Jésus « en un instant tous les royaumes de la terre » (Luc 4 :5). Puis il fit cette déclaration solennelle au Fils de Dieu :
« Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m’adores, elle sera toute à toi » (versets 6-7).
Bien entendu, Jésus reprit le diable, expliquant que seul Dieu doit être adoré (verset 8). Mais notez que le Fils de Dieu ne contredit pas une seule fois l’affirmation du diable ! Bien au contraire, Il accepta que Dieu ait donné à Satan une telle position d’autorité dans le monde. Lorsque le Christ appela Satan « le prince de ce monde », Il pesait bien Ses mots !
La vue d’ensemble apparaît lorsque nous rassemblons tous ces passages bibliques. L’archange Lucifer se vit confier la responsabilité de la Terre, peut-être avec un tiers des anges, pour accomplir les objectifs que le Créateur avait en tête. Cependant, rempli d’orgueil et d’ambition pécheresse, Lucifer entra dans un état d’iniquité qui le conduisit à effectuer une tentative insensée de s’emparer du trône de Dieu, à la tête d’une armée d’anges qu’il entraîna dans sa rébellion contre le Tout-Puissant.
L’apôtre Paul avertit l’évangéliste Timothée de prendre garde à ne pas confier de responsabilités à des nouveaux venus, de peur qu’ils ne se laissent gagner par l’ambition et l’orgueil, et ne tombent « dans la condamnation du diable » (voir 1 Timothée 3 :2-6, Ostervald). Le récit de l’origine de Satan explique certainement les préoccupations de l’apôtre Paul.
Le péché angélique entraîna la dévastation
Lorsque nous « rencontrons » le diable pour la première fois, à l’occasion de la tentation d’Ève, sous les traits du serpent du jardin d’Éden (Genèse 3 :1), notez qu’il était déjà en rébellion ! Ainsi, la responsabilité assignée à Lucifer et à ses anges sur la Terre, sa vanité et son orgueil démesurés, son ambition croissante, sa politique parmi les anges, sa rébellion, son ascension au-dessus des nuages, sa défaite et sa chute sur la Terre sont des événements qui se déroulèrent avant la « semaine de la création » décrite dans la Genèse !
Plus tôt, nous nous sommes demandé quelles entités moralement responsables, intelligentes et disposant du libre arbitre auraient pu exister et pécher avant Adam et Ève, causant ainsi le tohu-bohu, la ruine et la désolation, de la Terre. En nous basant sur la Bible, nous avons trouvé la trame d’un tel récit dans les paroles inspirées des Écritures.
Apparemment, le tohu-bohu qui s’est abattu sur la Terre (l’état de chaos, de ruine et de dévastation mentionné dans Genèse 1 :2) était le résultat du péché et de la rébellion contre le Créateur, comme le décrivent Ésaïe 34 :11 et Jérémie 4 :23. Peu importe qu’il s’agisse du résultat de la mauvaise gestion de la Terre par les anges déchus ou d’une punition directe de leur rébellion par le Tout-Puissant. Le péché entraîne toujours la destruction. C’est une loi de l’Univers, applicable à des civilisations entières comme à la vie de chaque individu !
Avec cette compréhension, nous voyons qu’au cours des sept jours formidables décrits dans la Genèse, Dieu ne créa pas le monde à partir de rien, mais Il en fit une restauration remarquable. Il restaura le monde magnifique qu’Il avait créé auparavant, mais qui avait été dévasté par la rébellion pécheresse de ceux qui étaient chargés d’en prendre soin. Voici comment Genèse 1 :1-2 pourrait être traduit :
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était [car elle était devenue] un désert et une ruine désolée ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »
L’image est claire. À un moment donné dans le passé, Dieu créa toutes choses, d’abord le monde spirituel et les êtres angéliques, puis le monde physique dont la Terre, comme le lieu dans lequel Son plan se déroulerait. Conformément à Ses desseins, la Terre nouvellement créée fut placée sous la direction de Lucifer et de ses anges, qui se rebellèrent finalement contre leur Créateur, laissant le monde dans un état de désolation. Après avoir vaincu cette rébellion, Dieu restaura le monde en l’espace d’une semaine, il y a environ 6000 ans, exactement comme le décrit la chronologie biblique. Le monde ainsi restauré est celui dans lequel nous vivons actuellement, mais il reste sous la domination de Satan le diable, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le Roi des rois, Jésus-Christ, lors de Son retour.
Des observations et des objections
Plusieurs choses doivent être notées à propos de cette compréhension de l’histoire du monde, à propos de ses tenants et de ses aboutissants, de ce qu’elle dit et ce qu’elle ne dit pas.
- Cette vérité est fondée sur les Écritures. Elle n’est pas basée sur les tentatives de réconciliation de la Bible avec la géologie et la théorie de l’évolution, ni sur les tentatives historiques d’autres individus.
- Les sept jours de la « semaine de la création » (qui, comme nous l’avons vu, était en réalité une semaine de “re-création”) restent sept périodes littérales de 24 heures, se succédant l’une après l’autre, il y a environ 6000 ans.
- Cette compréhension de l’histoire fournit peu de détails sur la Terre avant l’époque précédant le tohu-bohu, lequel marque une séparation entre le monde qui était sous l’administration des anges et celui qui a été recréé et remodelé par Dieu. Elle ne nous dit pas combien de temps la Terre « originelle » a existé avant l’avènement du tohu-bohu, ni quel type de vie physique a pu s’y trouver pendant cette période.
- Les Écritures indiquent clairement que l’humanité a été créée il y a seulement 6000 ans, lorsque Adam a été formé à partir de la poussière et Ève à partir d’une de ses côtes. Quelles que soient les formes de vie qui peuplèrent la Terre avant le tohu-bohu, Adam fut le tout premier homme (1 Corinthiens 15 :45, 47).
- Quelles que soient les formes de vie existant avant le tohu-bohu, il est clair qu’aucune d’entre elles n’a survécu à la destruction causée par la rébellion angélique. La Terre fut totalement renouvelée pendant la « semaine de la création ». Cela ne signifie pas que Dieu n’a pas recréé certaines plantes ou certains animaux qui existaient avant la destruction, ou qu’Il n’a pas créé de nouvelles plantes et de nouveaux animaux d’un genre similaire aux précédents, mais la période précédant la « semaine de la création » de la Genèse (une période au cours de laquelle la Terre était dans un état de chaos et de désolation à cause du péché des anges) représente une barrière temporelle infranchissable pour la vie physique. Toute vie sur Terre a recommencé avec la « semaine de la création » décrite dans Genèse 1.
Cette interprétation du début de la Genèse n’est pas exempte de critiques, mais la plupart d’entre elles peuvent être facilement levées. Les quatre plus importantes sont exposées par Ken Ham, un créationniste de la Jeune-Terre, dans son livre Le mensonge : évolution/millions d’années1 :
- Toutes les interprétations, comme celle-ci, qui prétendent voir dans la Bible une Terre plus ancienne « étaient pratiquement inexistantes avant 1800 apr. J.-C. » et ont été créées pour « tenter de s’adapter aux âges longs promus par la science uniformitariste ».
- La grammaire de Genèse 1 :2 exclut tout espace de temps important entre la création initiale et l’état de tohu-bohu décrit dans ce verset.
- Exode 20 :11 exclut la possibilité que les cieux et la Terre soient plus anciens que la « semaine de création » de la Genèse.
- Cette interprétation signifie que la mort et la souffrance devaient exister dans la création avant le péché d’Adam (ce qui s’oppose vraisemblablement à Romains 5 :12).
Comme vous pouvez le constater, plusieurs de ces points ont déjà été abordés. Par exemple, nous avons vu que la première critique est injustifiée et inexacte. La croyance en l’existence d’une période indéfinie avant le premier jour de la « semaine de la création » est très ancienne. Par exemple, Simon Bischop enseignait au début du 17ème siècle qu’un intervalle de temps était nécessaire, entre la création « à partir du néant » de Genèse 1 :1 et l’état du monde décrit dans Genèse 1 :2, pour « rendre compte de la chute des anges mauvais ».2 De telles conceptions existaient bien avant que Charles Darwin ne s’intéresse pour la première fois au bec d’un pinson. Elles ne peuvent être rejetées comme étant ancrées dans un effort de compromis avec l’évolution.
Cela étant, l’histoire écrite concernant ces conceptions n’a aucune importance par rapport à la question de savoir si elles sont véritables ou non selon la Bible. Comme nous l’avons déjà établi, cette compréhension est fondée sur le principe de laisser la Bible s’interpréter elle-même, pas sur l’imagination, les spéculations ou les efforts scientifiques des êtres humains.
Nous avons également déjà abordé la critique concernant la grammaire hébraïque, en notant qu’un certain nombre de spécialistes de l’hébreu ancien voient dans Genèse 1 :1-2 la possibilité d’un intervalle de temps, d’une durée non déterminée, avant le début de la « semaine de la création ». Il n’y a pas d’unanimité sur l’idée que la « grammaire » empêche cette compréhension. Certains, comme le Dr Richard Friedman, sont tout à fait convaincus que le langage grammatical de Genèse 1 :2 exige que les conditions de tohu-bohu précèdent le premier jour de la « semaine de la création ».
En ce qui concerne Exode 20 :11, la réponse est simple. Le quatrième commandement, qui concerne l’observation du sabbat divin du septième jour, stipule : « Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » Nul besoin de débattre de la « semaine de la création » elle-même, qui dura effectivement sept jours littéraux de 24 heures : six jours pendant lesquels Dieu a façonné (“a fait”) le merveilleux monde d’Adam et Ève, en le restaurant à partir de la désolation chaotique du passé, suivis d’un septième jour pendant lequel Dieu instaura le sabbat en se reposant et non en travaillant. De plus, le mot hébreu traduit par « fait » dans Exode 20 :11 est ‘asah, dont la signification est compatible avec une création faite à partir d’un matériau préexistant. Par exemple, il a été dit à Noé de « faire » (‘asah) l’arche avec du bois de gopher dans Genèse 6 :14 et non de fabriquer l’arche à partir de « rien ».
Il n’y a aucune contradiction entre l’œuvre merveilleuse de Dieu, lors de la « semaine de la création » il y a environ 6000 ans, décrite dans Exode 20 :11, et la ruine de la Terre qui précéda cette œuvre.3
La mort et la souffrance avant Adam ?
Enfin, le concept de la destruction, de la dévastation et de la mort des animaux avant l’existence d’Adam et Ève, et donc avant le premier péché de l’humanité, est-il en désaccord avec Romains 5 :12 ?
Dans ce verset, l’apôtre Paul nous dit que c’est « par un seul homme [que] le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché ». Le « seul homme » est clairement Adam. Nous devons accepter comme une vérité spirituelle fondamentale que nous subissons la souffrance, la douleur et la mort à cause du péché originel d’Adam et Ève. Tous les êtres humains après eux, à l’exception de Jésus-Christ, ont répété la même erreur, « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 :23). D’autres passages bibliques contiennent des affirmations similaires (voir 1 Corinthiens 15 :21-22).
Cela contredit-il l’idée que le péché des anges et la dévastation qui en a résulté se soient produits avant Genèse 1 :2 ? Pas du tout.
Nous devons d’abord noter que Romains 5 :12 parle spécifiquement de la mort humaine : le péché d’Adam (et tous les péchés qui ont suivi) a fait en sorte que « la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché ». C’est-à-dire que tous les êtres humains ont péché, à l’exception de Jésus-Christ.
Cependant, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Il est clair que le péché de Satan a précédé celui d’Adam. D’une manière ou d’une autre, le péché de Satan n’a-t-il pas causé de la souffrance ? Arrive-t-il que le péché ne produise pas de souffrance ?
S’il existait des formes de vie animale au cours de la période précédant le tohu-bohu, lorsque les anges étaient les gardiens du monde, la nature rebelle croissante de Lucifer et de ses subordonnés a assurément exercé une influence sur elles. Or, l’impact du péché est toujours synonyme de souffrance, de conflit et de douleur. Les preuves que nous donne le monde des dinosaures correspondent certainement à une telle description.
Pourtant, notre monde aurait pu être différent ! Après la restauration physique complète du monde et la création de l’humanité, Dieu déclara, avant Son repos sabbatique, que tout ce qu’Il avait fait était « très bon » (Genèse 1 :31). Il n’y avait aucune raison pour qu’il en soit autrement. Si Adam et Ève avaient choisi d’écouter leur Créateur plutôt que le diable, les choses seraient restées en l’état ! Mais ils ne l’ont pas fait. Suite à leur choix (un choix que nous avons tous répété à notre manière), la souffrance, la douleur et la mort sont entrées dans le monde ainsi restauré.
Notre compréhension de Genèse 1 :1-2 n’est assurément pas en contradiction avec Romains 5 :12.
Cela ne veut pas dire que cette compréhension réponde à toutes les questions possibles et imaginables. Comme pour toutes les autres explications des origines de la Terre, certaines questions restent sans réponse. Mais cette compréhension fournit de bien meilleures réponses que les autres explications, des réponses plus cohérentes avec tous les faits considérés dans leur ensemble. Néanmoins, le commentaire de l’apôtre Paul aux Corinthiens, selon lequel « nous connaissons en partie » au cours de cette vie (1 Corinthiens 13 :9, 12), devrait nous rappeler que les êtres humains ne trouveront jamais de réponse à chacune de leurs questions avant le retour de Jésus-Christ.
Avant de conclure, abordons deux autres questions parmi les plus fréquemment posées : quelle est la place des dinosaures dans tout cela ? Et qu’en est-il de l’homme ?
Chapitre 8
Qu’en est-il des dinosaures ?
Avec une telle compréhension de la chronologie biblique, les possibilités de comprendre l’histoire de la vie sur Terre sont beaucoup plus ouvertes que ce que les créationnistes de la Jeune-Terre sont prêts à accorder, mais bien plus étroites que ce que les évolutionnistes se permettent de percevoir.
Il est possible, voire probable, que la saga des dinosaures (et de tant d’autres créatures préhistoriques dont les fossiles ont été préservés) se soit déroulée entièrement avant le tohu-bohu et la recréation que nous voyons dans la Genèse, il y a environ 6000 ans. Si c’est le cas, les calendriers traditionnels en « millions ou milliards d’années » établis par les géologues et d’autres scientifiques pourraient être largement exacts, à l’exception des millénaires les plus récents où l’homme entre en jeu.
Un monde “à feu et à sang”
Si ces créatures n’ont existé que durant les âges précédant le tohu-bohu, alors le monde qu’elles occupaient était sous la direction du chérubin Lucifer et des anges sous son autorité, mais la Bible ne dit pas grand-chose d’autre sur cette époque. Cependant, notre expérience dans ce monde nous donne une base sur laquelle nous pouvons spéculer. Après tout, ce chérubin, aujourd’hui appelé Satan, est toujours le maître de ce monde (Jean 14 :30) et le « dieu » de ce « présent siècle mauvais » (2 Corinthiens 4 :4 ; Galates 1 :4). À quoi ressemble notre monde aujourd’hui sous son influence ?
Les preuves sont partout autour de nous. Nous vivons dans un monde « à feu et à sang ». Les prédateurs s’attaquent aux faibles et aux vulnérables. Tous se battent pour vivre au jour le jour. Ils sont en compétition. Manger ou être mangé. Survivre ou servir de nourriture à ceux qui survivent.
C’est ce que deviennent tous les royaumes lorsque ceux qui en ont la garde sont consumés par le péché.
La rébellion de Lucifer aurait assurément influencé le monde des dinosaures de la même manière. En revanche, les Écritures ne disent pas combien de temps ce monde a duré. Lorsqu’il n’y a pas d’êtres humains pour documenter le passage du temps, qu’est-ce qu’un millier d’années, voire un million d’années, pour ceux qui vivent dans le monde spirituel ? Nous savons que pour Dieu, mille ans sont comme un jour (2 Pierre 3 :8). Nous savons aussi que Dieu attend souvent pour agir dans le monde que les civilisations pécheresses aient atteint leur paroxysme (voir Genèse 15 :16 ; Daniel 8 :23). Il est possible que le monde ancien, avant l’avènement du tohu-bohu, n’ait connu qu’une gouvernance angélique de plus en plus entachée par le péché.
Cela étant, nous devons être prudents. Tout d’abord, nous devons nous rappeler qu’il s’agit uniquement d’une spéculation. Jésus a dit à Son Père : « Ta parole est la vérité » (Jean 17 :17). À moins que ce que nous disons ne soit confirmé par la parole de Dieu, il est toujours possible de se tromper. Il est possible, par exemple, que certaines créatures ressemblant à des dinosaures aient été créées après la fin du tohu-bohu. Il se peut que la grande majorité ait existé au cours des millions d’années ayant précédé la dévastation de la Terre par la rébellion satanique, mais que certains animaux similaires aient également fait partie de la recréation. La Bible parle d’animaux qui rappellent certainement des caractéristiques effrayantes des dinosaures, comme le béhémoth et le léviathan (Job 40 :10, 20 – note : la version Ostervald utilise les noms hébreux de ces animaux, tandis que la traduction Segond essaie de les faire correspondre à des animaux connus à notre époque). Peut-être que certaines de ces créatures plus tardives, faisant partie du monde succédant au jardin d’Éden, ont servi de base aux histoires de dragons et de grands serpents racontées par l’homme. Là encore, nous ne pouvons que spéculer.
Des créations du diable ou de Dieu ?
Nous devons également faire attention aux conclusions que nous pourrions être tentés de tirer au sujet des dinosaures. Certains regardent les traits effrayants du célèbre tyrannosaure et supposent inconsidérément qu’un animal aussi cruel doit être une « création » du diable et non de Dieu. Cependant, la Bible n’attribue jamais au diable le mérite d’avoir créé quoi que ce soit, du moins pas de la manière dont Dieu est capable de créer. En fait, si quelqu’un pense que seules les créatures de la préhistoire peuvent être cruelles, il devrait regarder plus souvent des documentaires sur la nature ! La scène d’un lion affamé capturant une gazelle solitaire et commençant à dépecer l’animal blessé, alors que son corps est encore chaud, devrait suffire à convaincre n’importe quelle personne que le passé n’a pas le monopole des animaux cruels.
Pourtant, c’est à Dieu que revient le mérite de la capacité du lion à chasser et à tuer sa proie, tout comme c’est à Lui que revient le mérite de toute la merveilleuse conception que nous voyons dans la nature. Chaque aspect de Sa création est une louange à Dieu (Psaume 148). Nous ne devrions jamais donner au diable l’honneur et la gloire qui n’appartiennent qu’à Dieu. Le Tout-Puissant a créé toutes choses par Jésus-Christ, comme le déclare la Bible : « Toutes choses ont été faites par elle [c.-à-d. par la Parole, qui est Jésus-Christ], et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle » (Jean 1 :3). Il est difficile de trouver une déclaration plus catégorique que celle-ci.
Même lorsque l’homme entre en scène et commence à élever des animaux dans le but d’accentuer ou de renforcer des compétences et des caractéristiques spécifiques (par exemple, la capacité d’un chien de Saint-Hubert à détecter les odeurs les plus faibles ou l’intelligence d’un border collie), nous ne faisons que profiter, pour le meilleur ou pour le pire, de la remarquable machinerie et de la programmation de la vie, pour lesquelles Dieu reçoit, encore une fois, tout le mérite.
Il en va de même pour les dinosaures. Ces créatures étaient équipées par Dieu pour survivre dans leur monde, tout comme les lions, les cobras et les grizzlis sont équipés par Dieu pour survivre dans le nôtre. Quiconque regarde le squelette fossilisé d’un féroce allosaure ou celui d’un imposant brachiosaure (comme celui de 13 m de haut exposé au musée d’histoire naturelle de Berlin) et ressent le besoin de louer Dieu pour la puissance et la grandeur qui se reflètent dans la conception de ces animaux est en droit de le faire. Dieu Lui-même utilisa les qualités terribles et effrayantes du léviathan pour faire comprendre Sa propre majesté à Job.
Les dinosaures et l’homme
Si la plus grande partie de l’histoire du monde se situe dans un passé très ancien, avant le tohu-bohu et avant la création du jardin d’Éden il y a 6000 ans, et si tous les dinosaures ou la plupart d’entre eux ont vécu à cette époque préhistorique, cela expliquerait pourquoi il y ait si peu de preuves montrant que l’homme et les dinosaures auraient pu vivre en même temps. L’humanité n’existe que depuis sa création, il y a 6000 ans, après la restauration de la Terre qui avait été ravagée. Ces dinosaures et les autres formes de vie extrêmement anciennes n’auraient jamais vu un seul être humain.
Les créationnistes de la Jeune-Terre vantent souvent des preuves qui pourraient être interprétées comme suggérant que l’homme et les dinosaures auraient pu vivre ensemble. Attardons-nous un instant sur les faits. En 2007, lorsque Mary Schweitzer trouva des tissus mous dans un os fossilisé de tyrannosaure, daté de 68 millions d’années, beaucoup de ses collègues paléontologues écartèrent cette possibilité. L’idée préalablement reçue voulait que des tissus tels que les globules rouges ne puissent pas survivre aussi longtemps et que la fossilisation détruise tous les composants des tissus mous.
Et pourtant, tout était bien là, sous son microscope. Des preuves irréfutables de la présence de tissus mous.
Ce n’était que la première découverte. Depuis lors, les paléontologues ont découvert d’autres échantillons, aussi petits soient-ils, dans des os fossilisés ; pas assez pour recréer Jurassic Park, mais suffisamment pour faire l’objet d’une étude fascinante. À propos de ces résultats et de la leçon tirée de la persévérance de Schweitzer, le paléontologue Thomas Holtz a déclaré : « Il y a beaucoup de choses vraiment fondamentales dans la nature à propos desquelles les gens font des suppositions. »1
À la grande déception de Mary Schweitzer, sa découverte fut présentée par les créationnistes comme la preuve que la fossilisation se produit beaucoup plus rapidement qu’on ne le pense et que les os de dinosaures doivent être beaucoup plus jeunes qu’on ne le croit. Bien qu’elle se revendique chrétienne, elle n’est pas d’accord avec de telles conclusions et note qu’elle est absolument sûre de l’âge de la couche dans laquelle les ossements ont été trouvés : 68 millions d’années. En parlant des créationnistes de la Jeune-Terre, elle déclara : « Ils vous traitent mal. Ils déforment vos mots et manipulent vos données. »2
Cette description ne correspond pas à tous les défenseurs de la Jeune-Terre, dont la plupart sont très sincères dans leur désir de comprendre. Mais aucun d’entre nous n’est à l’abri de la tentation de sélectionner ses données, en applaudissant immédiatement les résultats qui soutiennent nos théories favorites, mais en rejetant tout aussi rapidement ceux qui semblent les contredire. Lorsqu’il s’agit des « preuves » montrant que l’homme aurait vécu aux côtés des dinosaures, la plupart des résultats cités sont très soigneusement choisis.
Pendant un temps, des empreintes de pas relevées dans la vallée de la rivière Paluxy, près de Fort Worth, au Texas, furent présentées par certains créationnistes de la Jeune-Terre comme la preuve que les hommes et les dinosaures avaient marché ensemble à la même époque. Plus récemment, les défenseurs de la Jeune-Terre ont pris leurs distances avec cette conclusion.3 Les gravures humaines que certains interprètent comme représentant des dinosaures révèlent souvent avoir des explications beaucoup plus banales, surtout lorsqu’on les examine de plus près. Comme nous l’avons déjà mentionné, les références historiques aux dragons et autres bêtes similaires, si elles sont fondées sur des faits, pourraient être basées sur des rencontres humaines avec des bêtes ressemblant à des dinosaures, mais créées après le tohu-bohu. Elles ne prouvent pas que l’homme ait coexisté avec de véritables dinosaures.
Ken Ham, et c’est tout à son honneur, a reproché à d’autres par-tisans de la Jeune-Terre de s’emparer trop vite de certaines « découvertes », les considérant comme des « preuves » de leur théorie et les utilisant pour combattre les « preuves » de l’autre camp.4 Malheureusement, beaucoup de gens pratiquent encore cette sélection arbitraire, au détriment de la crédibilité de leur camp.
Tout observateur honnête devrait convenir que les « preuves » d’une cohabitation entre humains et dinosaures sont pratiquement inexistantes. Compte tenu de l’impression qu’aurait laissée dans l’histoire de l’humanité la cohabitation de l’homme et des dinosaures à la même époque, l’absence de documents ou de preuves crédibles en attestant devrait être considérée comme une preuve positive qu’elle n’ait pas eu lieu.
Une question bien plus intéressante
La question de savoir si les dinosaures ont uniquement vécu dans le monde géré par les anges, avant la désolation du tohu-bohu, ou si certains d’entre eux (ou des animaux leur ressemblant) auraient pu vivre dans le monde que Dieu renouvela et recréa il y a environ 6000 ans, est assurément une question intéressante, mais ce n’est pas la plus intéressante.
Au lieu de savoir d’où vient le monde, la plupart d’entre nous veulent savoir d’où nous venons. Quelle est l’origine de l’humanité ? A-t-elle évolué ? Que devons-nous penser des « arbres évolutifs » de l’espèce humaine que nous trouvons dans les manuels de biologie et d’anthropologie ?
L’histoire du monde est fascinante. Mais notre histoire devrait retenir davantage notre attention.
Chapitre 9
Qu’en est-il de l’homme ?
Bien que le débat sur l’évolution et la création puisse se poursuivre jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne pour le régler en personne, une grande partie de ce débat est centrée sur une question en particulier : l’humanité a-t-elle évolué ? Même si l’évolution a été enseignée dans nos écoles pendant des décennies, la question est loin d’être réglée dans l’esprit du public, même parmi les non-religieux. Par exemple, au Canada, pays relativement laïc, une enquête menée sur trois ans a révélé que 38% des athées canadiens (personnes qui croient que Dieu n’existe pas) ne pensent pas que l’évolution puisse expliquer la conscience humaine et 31% pensent que l’évolution « ne peut pas expliquer l’origine des êtres humains ».1 Encore une fois, il s’agit seulement des pourcentages des athées et non de ceux qui croient en Dieu. Il est clair que ces doutes ne sont pas motivés par des préoccupations ou des questions d’ordre religieux.
Mais le doute est-il permis ? Après tout, la représentation d’une créature ressemblant à un singe ou à un chimpanzé se transformant, étape par étape, en un humain moderne (voire en un “homme des cavernes”) est une des représentations symboliques de l’évolution les plus populaires dans la conscience du public. Si certains en doutent, beaucoup d’autres considèrent l’évolution de l’homme comme une évidence.
Nous avons évoqué précédemment les rares reconstitutions hypothétiquement complètes de lignées de « fossiles de transition », comme celles proposées pour les chevaux et les baleines. Pourtant, la lignée fossile supposée qui est souvent présentée comme la plus complète et la mieux comprise est celle de l’humanité. Comme l’écrit le scientifique et géologue Casey Luskin :
« Les scientifiques évolutionnistes disent souvent au public que les preuves fossiles de l’évolution darwinienne de l’homme à partir de créatures simiesques sont incontestables. Par exemple, le professeur d’anthropologie Ronald Wetherington a témoigné devant le Conseil de l’éducation de l’État du Texas, en 2009, que l’évolution humaine présente “vraisemblablement la séquence de successions fossiles la plus complète de tous les mammifères du monde. Il n’y a pas de lacunes. Pas d’absence de fossiles de transition […] Ainsi, lorsque les gens parlent de l’absence de fossiles de transition ou de lacunes dans les archives fossiles, ce n’est absolument pas vrai. Et ce n’est pas vrai en particulier pour notre espèce.” Selon Wetherington, le domaine des origines humaines offre “un bel exemple de ce que Darwin considérait comme une évolution graduelle” »2 (C’est nous qui accentuons).
Pourtant, comme le note Luskin, « en creusant dans la littérature technique, on découvre une histoire radicalement différente de celle présentée par Wetherington et d’autres évolutionnistes engagés dans les débats publics ».3
La déclaration de Wetherington ne semble-t-elle pas suspecte à première vue ? Pourquoi les roches qui constituent les archives fossiles seraient-elles à ce point biaisées qu’elles donneraient aux êtres humains leur propre lignée par opposition à celle des autres « animaux » ? Pourquoi l’humanité devrait-elle dominer les archives fossiles des derniers millions d’années ? Comment comprendre ces supposés « ancêtres humains » ?
Avant de nous plonger dans la science, rappelons la vérité de la parole de Dieu concernant l’humanité. Dieu affirme clairement que l’humanité fait partie de Sa création. Il l’a créée le même jour que les animaux lors de Sa restauration du monde, mais Il affirme tout aussi clairement que l’humanité n’est pas une espèce animale parmi les autres dans cette création. L’humanité représente une catégorie unique en son genre.
Une création à part
Le témoignage de Dieu dans les pages de la Bible, que nous avons étudié précédemment, est absolument clair : l’homme est le résultat de la création divine. Bien qu’il ait pu y avoir un monde sous la garde des anges avant les 6000 dernières années, un monde dévasté par leur péché et qui a eu besoin d’être renouvelé par la main de Dieu, l’humanité fut amenée à l’existence pour la première fois au cours du sixième jour de cette « semaine de la création ».
Nous lisons dans Genèse 1 :26-28 :
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
En tant que seules créatures sur Terre créées à l’image de Dieu, l’homme et la femme ont reçu des responsabilités et une autorité qui reflètent celles de Dieu, telles que la domination sur la planète et les créatures qui leur sont inférieures. Même le commandement « Soyez féconds, multipliez » reflète l’objectif du Père et du Fils de se reproduire au travers de la création de l’humanité.4
C’est l’histoire des origines de l’humanité racontée par Dieu dans la Bible. La création du premier homme et de la première femme, Adam et Ève, eut lieu il y a environ 6000 ans, à partir de la poussière de la Terre.
D’un point de vue biblique, il n’y a aucune raison de considérer ce récit comme une simple métaphore ou quelque chose de symbolique. Il peut aller à l’encontre des désirs des matérialistes naturalistes d’aujourd’hui et de leur approche « sans Dieu » de la compréhension du monde, mais cela ne l’invalide pas pour autant. Toutes les références à ce couple dans les Écritures, y compris celles de l’apôtre Paul et de Jésus-Christ Lui-même, les considèrent comme de véritables êtres humains, les premiers de leur espèce, qui sont le père et la mère physiques de toute l’humanité (par ex. Romains 5 :14 et Matthieu 19 :4).Les détails bibliques concernant la durée de vie des patriarches et la durée des différents règnes permettent de dater sans ambiguïté leur création à environ 6000 ans. Sur ces points, le témoignage de la parole de Dieu est clair.
Alors, si l’humanité est apparue il y a seulement six millénaires, si Adam et Ève ont vraiment été les premiers de leur espèce, créés à l’image de Dieu, que devons-nous penser des os et des fossiles exposés dans les musées du monde entier, décrits comme les restes d’anciens ancêtres humains et présentés comme la preuve que l’humanité s’est développée à partir d’ancêtres simiesques vivant il y a des millions d’années ?
Quelle est la solidité des preuves de l’évolution humaine ? Un examen exhaustif des affirmations des évolutionnistes dépasse le cadre de cette brochure, mais même un examen succinct de l’évolution des « origines humaines » laisse planer de nombreux doutes sur cette théorie.
Comprendre les homininés
Leurs ossements, généralement leurs crânes, et les noms d’espèces qui leur sont attribués sont souvent disposés sur des arbres évolutifs dans les manuels scolaires et les documentaires scientifiques. Certains d’entre eux semblent clairement humains. D’autres, moins.
Ce sont les homininés, le nom attribué par certains paléoanthropologues à la lignée évolutive présumée de l’humanité qui remonte à des millions d’années.
Par souci de simplicité, nous utiliserons dans ce chapitre le mot homininé pour désigner l’ensemble de ce groupe (dans les références, ce mot est parfois légèrement différent d’hominidé), mais l’emploi d’un terme ou d’un autre pour impliquer le regroupement de ces créatures en une lignée de descendants et d’ancêtres n’en fait pas une théorie correcte.5
Comme nous le verrons, même en dehors du témoignage inspiré de la Bible, il y a de bonnes raisons scientifiques de mettre en doute l’exactitude de ces prétendus « arbres généalogiques ». En fait, il y a de bonnes raisons de remettre en question presque tout ce qui est affirmé à leur sujet.
La paléoanthropologie (l’étude des fossiles et autres vestiges pour tenter de comprendre ce qu’est censée être l’évolution humaine) est une science pleine de défis. Une des principales difficultés réside dans le fait que les fossiles découverts à ce jour sont relativement rares et, souvent, ce ne sont que de simples fragments d’os. Le paléontologue Stephen Jay Gould a écrit que « la plupart des fossiles d’hominidés, même s’ils servent de base à des spéculations sans fin et à des récits élaborés, sont des fragments de mâchoires et des éclats de crânes ».6
La situation n’a guère changé depuis que Gould a écrit ces lignes, il y a une quarantaine d’années. On trouve ici et là des squelettes remarquablement complets (et rares), mais les « fragments et les éclats » sont la règle et non l’exception.
Or, les preuves sont rares, mais les émotions sont vives. Comme l’a écrit le paléoanthropologue Roger Lewin : « Il y a une différence. Il y a quelque chose d’indiciblement émouvant à bercer dans ses mains un crâne issu de sa propre ascendance. »7
Seul un naïf pourrait supposer que de telles émotions n’ont pas d’incidence sur l’interprétation des découvertes de fossiles. Après tout, qui voudrait revendiquer la découverte d’un ancien ancêtre des chimpanzés ou des gorilles, alors qu’une interprétation bien plus « indiciblement émouvant[e] » est si tentante ?
Pourtant, si nous mettons de côté les émotions, l’assemblage d’un arbre évolutif précis (en supposant, pour les besoins de l’argumentation, qu’il en existe un) à partir des fragments trouvés représente un défi technique qui est rarement reconnu en public. Les résultats présentent un niveau d’incertitude et de spéculation qui, lui aussi, est rarement mentionné.
En 1999, les anthropologues Mark Collard, du University College de Londres, et Bernard Wood, de l’université George Washington, ont testé la fiabilité de la création d’arbres évolutifs pour l’humanité sur la base des caractéristiques crânio-dentaires (mesures du crâne et des dents). De manière ingénieuse, ils ont utilisé les mêmes techniques crânio-dentaires que celles appliquées aux fossiles d’homininés et les ont appliquées aux os de divers primates, tels que les babouins, les gorilles, les macaques, les orangs-outans et les chimpanzés. Ils ont ainsi pu tester « l’arbre évolutif » des primates qui en résultait et le comparer avec les liens de parenté que nous connaissions déjà concernant ces animaux.
L’arbre ainsi obtenu ne correspondait pas du tout aux relations réelles entre les animaux. Les techniques utilisées pour regrouper et classer les ancêtres supposés de l’homme ont échoué lamentablement à regrouper correctement les primates connus. Collard et Wood ont conclu à ce sujet :
« Ces résultats indiquent que nous ne pouvons guère faire confiance aux phylogénies [arbres évolutifs] générées uniquement à partir de preuves crânio-dentaires de primates supérieurs. Le corollaire est que les hypothèses phylogénétiques existantes concernant l’évolution humaine ont peu de chances d’être fiables »8 (c’est nous qui accentuons).
Le manque de fiabilité de ces efforts de création « d’arbres évolutifs » s’ajoute au fait que nous ne savons rien de la biologie des tissus mous de chaque spécimen (par exemple, les organes). De plus, hormis les indices fournis par les artefacts, nous ne savons presque rien des habitudes, des comportements et des capacités des créatures anciennes.
La prévalence des interprétations personnelles
Le faible nombre de fossiles disponibles, l’absence d’informations en dehors de ces fossiles, ainsi que les passions et la politique liées à la pratique de la paléoanthropologie font de la science des « origines humaines » un domaine qui donne lieu à beaucoup de spéculations et d’interprétations personnelles. Souvent, les découvreurs ne savent pas si leur petite collection d’ossements provient du même organisme ou d’individus différents, voire d’espèces différentes.
En citant Earnest Hooten, éminent anthropologue de Harvard, Roger Lewin fit ce commentaire à propos de la tentation d’appliquer une interprétation personnelle quand il s’agit d’expliquer les restes d’homininés :
« La tendance à valoriser un spécimen rare ou unique de la part de son découvreur, ou de la personne à qui sa description scientifique initiale a été confiée, découle naturellement de l’égoïsme humain. C’est presque inéluctable. [Cet individu] ne négligera probablement aucun ossement dans ses efforts de trouver des particularités nouvelles et frappantes qu’il pourrait interpréter sur le plan fonctionnel ou généalogique. À moins d’être très expérimenté, il sera enclin à découvrir de nouvelles caractéristiques qui seront, en partie, le fruit de sa propre imagination »9 (c’est nous qui accentuons).
En décrivant la nature inévitable de ce type de travail, le paléoanthropologue Richard Leakey écrivit à propos du supposé ancêtre humain Homo habilis :
« Sur les quelques dizaines de spécimens qui auraient supposément appartenu à cette espèce, à un moment ou à un autre, au moins la moitié ne l’est probablement pas. Mais il n’y a pas de consensus sur les 50% à exclure. Les 50% d’un anthropologue ne sont pas les mêmes que ceux d’un autre. »10
Il est facile de penser que de telles faiblesses n’affectent que les découvertes individuelles ou les découvreurs eux-mêmes, mais pas l’étude des « origines humaines » de manière systémique. Nous pourrions nous dire qu’après tout, les détails sont peut-être flous, mais que la vue d’ensemble ne peut pas être très éloignée de la vérité.
Un tel raisonnement est erroné. La possibilité d’une vaste erreur a été puissamment illustrée par une découverte unique à Dmanissi, en Géorgie, juste au nord de la frontière avec l’Arménie.
Les cinq crânes de Dmanissi
En 2013, la revue Science publia une étude, fruit de plusieurs années de recherche, sur l’analyse de cinq crânes d’homininés découverts au même endroit, à Dmanissi, en Géorgie (Caucase). En employant les méthodes conventionnelles, ils furent datés d’environ 1,8 million d’années.
Quelle que soit la méthode utilisée, la découverte de Dmanissi est spectaculaire. Le « crâne Dmanissi 5 » est considéré comme le plus complet jamais trouvé pour cette période. La découverte de ces crânes et leur analyse ont suscité une controverse qui perdure encore aujourd’hui, principalement en raison de la diversité de cette collection, y compris la diversité surprenante des ossements du seul crâne n°5, censé être celui d’un Homo habilis.
Les crânes sont tellement différents les uns des autres qu’un des auteurs de l’étude fit remarquer qu’il serait tentant de déclarer qu’ils appartiennent chacun à une espèce distincte. Une analyse ultérieure a confirmé l’idée que les paléoanthropologues ont « multiplié » inutilement les espèces humaines, montrant qu’au moins trois espèces « humaines » anciennes (Homo erectus, Homo habilis et Homo rudolfensis) n’étaient pas trois lignées évolutives distinctes, mais la même espèce.12
Le responsable des fouilles, David Lordkipanidze, a expliqué : « Si on trouvait les crânes de Dmanissi sur des sites isolés en Afrique, certains leur donneraient des noms d’espèces différents. Mais une seule population peut présenter toutes ces variations. Nous utilisons cinq ou six noms, mais ils pourraient tous provenir d’une seule lignée »13 (C’est nous qui accentuons).
Tim White, directeur du Laboratoire d’études de l’évolution humaine, fit remarquer que « certains paléontologues voient des différences mineures dans les fossiles et leur donnent des étiquettes, ce qui a permis à l’arbre généalogique d’accumuler un grand nombre de branches ». Cependant, il est possible qu’une grande partie de cet « arbre » ne soit qu’une illusion. Selon le Dr White, « les fossiles de Dmanissi nous donnent une nouvelle mesure de référence, et lorsque vous l’appliquez aux fossiles africains, une grande partie de ce bois supplémentaire dans l’arbre est du bois mort. C’est beaucoup de bruit pour rien. »
Le débat sur les cinq crânes de Dmanissi est toujours très vif. Mais songez aux implications : une seule découverte peut redessiner complètement « l’arbre évolutif » de l’homme communément accepté et effacer l’existence de plusieurs espèces humaines (présumées). À quel point les théories sur lesquelles reposent ces conclusions sont-elles fragiles ?
Quelle que soit la confiance affichée dans les hypothétiques « arbres évolutifs » humains présentés par les musées, les manuels scolaires et les documentaires télévisés, il y a de nombreuses raisons de remettre en question « l’orthodoxie » de l’évolution humaine, lorsque nous approfondissons le sujet.
Que penser des fossiles d’homininés ? Voyons comment ils pourraient s’inscrire dans la vérité que Dieu a révélée à propos de la création et de l’humanité.
Des singes et des hommes
Pour ceux qui ne s’accrochent pas à l’orthodoxie évolutionniste, l’élément le plus frappant réside dans les différences marquées entre deux groupes de ces supposés « ancêtres » et « parents » de l’être humain. Certains fossiles rappellent très clairement les humains, tandis que d’autres sont beaucoup plus proches des singes et des chimpanzés.
Les fossiles entrant dans la catégorie des australopithèques semblent appartenir davantage aux espèces simiesques. Bien qu’ils soient présumés être des ancêtres (ou des parents évolutifs) de l’homme, le lien entre ces créatures et l’humanité n’est qu’une spéculation. Au-delà du désir des scientifiques d’établir un « arbre évolutif » humain et de la présomption qu’un tel arbre puisse être établi, il n’y a aucune raison solide de croire que ces créatures soient des ancêtres de l’humanité.
En revanche, d’autres fossiles, dont beaucoup appartiennent au genre Homo, semblent bien plus proches de l’homme.
Les idées préconçues basées sur l’évolution ont souvent incité les artistes à représenter ces créatures sous des traits de singes ou d’animaux primitifs. Mais en faisant abstraction de ces idées préconçues, les représentations artistiques de créatures telles que Homo neanderthalensis (l’Homme de Néandertal) et Homo erectus, basées simplement sur leurs os, tendent à les faire ressembler à l’un d’entre nous.
En fin de compte, les appellations Homo neanderthalensis, Homo erectus et même Homo sapiens (la désignation donnée aux humains actuels) ne sont que des catégories créées par des scientifiques. Elles ne représentent pas des limites établies par Dieu, mais des désignations faites par des hommes qui s’efforcent de donner un sens au monde, souvent sans l’aide de Dieu et en partant du principe que l’évolution humaine est un fait.
Tous les descendants d’Adam et Ève doivent-ils ressembler exactement à ce que nous sommes aujourd’hui ? Doivent-ils tous avoir la même taille et la même corpulence ? Même en omettant la diversité que nous observons de nos jours au sein de l’espèce humaine, la Bible décrit une diversité encore plus grande dans les temps passés. Selon le texte massorétique de 1 Samuel 17 :4, le « géant » Goliath, célèbre pour son duel avec David, mesurait « six coudées et un empan », soit environ trois mètres. D’autres passages bibliques parlent de « géants », comme Genèse 6 :4 et Nombres 13 :33. Si l’humanité est capable d’une telle diversité, les Néandertaliens ne pourraient-ils pas simplement faire partie de la diversité de l’espèce humaine créée à l’image de Dieu ?
Après avoir noté que les capacités cérébrales des crânes d’Homo erectus et d’Homo neanderthalensis se situent dans la fourchette connue des crânes humains modernes, Casey Luskin écrivit à propos des Néandertaliens que les chercheurs modernes ont dû revoir les descriptions et les images antérieures qui les représentaient comme des « précurseurs primitifs et maladroits des êtres humains modernes ». Le temps a montré que les Néandertaliens étaient probablement très proches de nous, autrement dit « des gens comme les autres ».15
Des descendants d’Adam ?
Les Néandertaliens descendaient-ils d’Adam et Ève, comme tous ceux d’entre nous aujourd’hui ? Le principal obstacle à cette théorie est la chronologie géologique standard attribuée à ces espèces : les dates remontent généralement à deux millions d’années.
Mais cette chronologie est-elle correcte ? En effet, si l’échelle de temps traditionnellement exprimée en centaines de milliers ou en millions d’années est correcte, alors ces créatures ne peuvent pas être humaines, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas descendre d’Adam et Ève. Comme nous l’avons vu, la Bible indique clairement que l’humanité a été créée il y a 6000 ans, lorsqu’elle fut placée dans le jardin d’Éden. Même si tous les autres fossiles correspondent aux dates anciennes traditionnellement établies par la science moderne (les plaçant avant l’époque du tohu-bohu dont nous avons parlé précédemment), nous savons que l’humanité n’existait pas avant la recréation décrite dans la Genèse. L’homme et la femme sont une création unique de Dieu qui existe uniquement depuis l’époque succédant au cataclysme qui entraîna la désolation mentionnée dans la Genèse 1 :2.
Si les méthodes utilisées pour dater ces fossiles d’homininés sont correctes, alors il ne s’agit assurément pas d’êtres humains, car ils ne peuvent pas descendre d’Adam et Ève. Au mieux, ils pourraient représenter une sorte de « singe bipède avancé », mais il ne s’agirait pas d’êtres humains créés à l’image de Dieu.
Il y a pourtant de bonnes raisons de remettre en question les méthodes de datation utilisées pour déterminer l’âge de certains fossiles d’homininés. L’examen des principes scientifiques et des présomptions qui sous-tendent un grand nombre de ces méthodes dépasse le cadre de cette brochure, mais il y a lieu d’envisager de multiples possibilités. Parmi les facteurs bibliques susceptibles d’exercer une influence sur les estimations temporelles figurent les questions relatives à l’état du monde entre le jardin d’Éden et le déluge de Noé.
Bien que le déluge de la Genèse ne puisse pas résoudre tous les problèmes auxquels est confronté le scénario de la Jeune-Terre, il est vrai que le monde restauré personnellement par Dieu il y a 6000 ans ait pu être légèrement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Dans Genèse 6 :13, Dieu dit à Noé qu’Il détruirait « toute chair » autre que les créatures marines et les personnes protégées dans l’arche, mais aussi qu’Il allait « les détruire avec la terre ». Il est clair que les conditions environnementales du monde après le déluge étaient radicalement différentes de celles qui avaient prévalu pendant les 15 siècles qui s’étaient écoulés entre la recréation parfaite et le déluge, comme en témoigne la diminution spectaculaire de la durée de vie des patriarches, décrite dans le livre de la Genèse. Nous ne connaissons pas les détails de la manière dont cet environnement a pu différer, comme les différences atmosphériques ou les niveaux de radiation.
Quoi qu’il en soit, nous savons que la Bible situe la création de l’homme il y a environ 6000 ans. Par conséquent, la civilisation humaine, au sens propre du terme, n’est pas plus ancienne que cela. Pourtant, les scientifiques affirment qu’il existe des civilisations humaines qui remonteraient à des dizaines de milliers d’années.16 Si ces civilisations étaient réellement humaines, alors leurs méthodes de datation sont erronées. Dans ce cas, nous pourrions découvrir que des créatures telles que les Néandertaliens ne sont pas des animaux évolués, mais de véritables humains, descendants d’Adam et Ève, créés à l’image de Dieu et destinés à un but qui dépasse l’imagination.
Être honnêtes sur ce que nous savons et ne savons pas
L’interprétation correcte des fossiles humains et simiesques que nous continuons à découvrir est un travail en cours, non seulement dans le domaine de la religion, mais aussi de la science laïque et « sans Dieu ». Il semble que la paléoanthropologie soit seulement en train de commencer à rédiger l’introduction et non le dernier chapitre de ce sujet.
Peut-être découvrirons-nous que les chronologies standard sont exactes et que de nombreuses créatures présentées comme des ancêtres de l’humanité ne sont rien d’autre que des animaux bipèdes ressemblant à des singes. Le règne animal présente de nombreux exemples impressionnants d’intelligence sous-humaine, que ces anciennes créatures auraient également pu posséder, sans pour autant franchir la ligne qui sépare intelligence exponentiellement supérieure de l’être humain.
Ou peut-être découvrirons-nous que les chronologies sont erronées, et que l’Homme de Néandertal et l’Homo erectus sont des descendants d’Adam, au même titre que l’Homo sapiens actuel. Nous avons de bonnes raisons de croire que c’est le cas. Quant aux australopithèques et aux autres créatures ressemblant davantage à des singes, ils ne seraient que des animaux, des créatures non humaines ayant vécu avant ou après le tohu-bohu, voire avant et après.
Nous devons avoir l’honnêteté de reconnaître que nous ne connaissons pas toutes les réponses sur ce point précis.
Quelle que soit la manière dont les faits seront finalement compris, la vérité se révélera être en accord avec la parole de Dieu. La façade de « l’évolution humaine » qui a été érigée à sa place sera alors considérée pour ce qu’elle est : un mythe déguisé sous l’apparence de la science. En effet, comme nous l’avons vu, les fissures dans cette façade sont de plus en plus visibles.
Chapitre 10
Où allons-nous maintenant ?
Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Prenons le temps de résumer ce que nous avons vu. Les évolutionnistes, qui présentent comme un fait établi que des processus matérialistes non guidés aient produit toute la vie sur Terre à partir d’un seul ancêtre, ne sont pas conséquents avec eux-mêmes puisqu’ils ne basent pas leur théorie sur des faits vérifiables. L’observation de Thomas Nagel, citée dans l’introduction, continue de sonner juste. Lorsque nous sommes confrontés à la théorie selon laquelle toute vie a été produite par des processus naturels et sans but, l’incrédulité est une réaction rationnelle et justifiable. Si les évolutionnistes veulent que le monde accepte leur théorie comme un fait, ils doivent apporter beaucoup plus d’explications que ce dont ils sont en mesure de faire actuellement. En attendant, l’idée que la complexité de la vie a été conçue par une intelligence bien plus grande est beaucoup plus crédible et plus cohérente d’un point de vue factuel.
Quant aux créationnistes de la Jeune-Terre, bien qu’ils fassent preuve d’un dévouement juste et admirable envers la vérité littérale de la Bible, ils imposent à la création une exigence qui ne trouve pas son origine dans la parole de Dieu.
La Bible décrit un événement de création qui s’est produit il y a environ 6000 ans. L’humanité fait partie de cet événement, lorsque nos premiers ancêtres ont vu le jour sous les traits d’Adam et Ève. Mais les Écritures nous montrent également que cet événement était en réalité une « re-création » du monde, car le précédent, sous la garde de Lucifer et de ses anges, avait été dévasté suite à leur rébellion contre leur Créateur. Bien que la parole de Dieu situe clairement le jardin d’Éden et la « semaine de la création » (six jours de renouvellement de la création, suivi d’un sabbat le septième jour) il y a environ 6000 ans, elle n’explique pas quand le Tout-Puissant créa « les cieux et la Terre ». Il y a eu une période au cours de laquelle le monde, sous la garde des anges, a été détruit et ruiné à cause de leur péché. Cette destruction marque l’avènement de l’état de tohu-bohu, qui est un tournant décisif de l’histoire de notre planète.
Que devons-nous faire à présent ?
Si nous sommes convaincus qu’il s’agit de la véritable histoire du monde, basée sur une lecture précise de la Bible et une compréhension plus raisonnable des découvertes scientifiques, que devons-nous faire à présent ? Comment aller de l’avant ? Le débat opposant l’évolution à la création ayant été si intense, existe-t-il une issue possible ?
La réponse est affirmative. Mais il faut faire preuve d’humilité, ce qui semble être une denrée rare de nos jours.
Il serait peut-être trop simple de demander à tout le monde de « s’entendre », mais il existe des mesures réelles et concrètes que chacun pourrait prendre pour transformer les efforts disparates d’exploration des origines de la vie en une action coordonnée et collective de la recherche de la vérité. Voici les mesures que chaque « camp » pourrait prendre à cet égard.
À l’attention des évolutionnistes
Premièrement, soyez honnêtes et reconnaissez publiquement les lacunes de vos théories et les désaccords dans vos rangs. Les discussions animées et les fortes divergences d’opinions doivent apparaître sur la place publique, pas seulement dans les revues professionnelles ou dans les journaux à diffusion confidentielle. Lorsqu’un média populaire souhaite présenter votre théorie favorite comme « la » solution par excellence, résistez à la tentation. Ceux d’entre vous qui présentent publiquement leur explication préférée des phénomènes de la vie comme étant « la seule vraie voie » (même s’ils font parfois référence à d’autres possibilités) nuisent à leur profession et à la crédibilité de tous les scientifiques. Beaucoup veulent imputer la perte de « foi » (de confiance) dans les déclarations des spécialistes à un public crédule et prêt à croire n’importe quoi, mais ils devraient plutôt considérer le fait que le public est devenu méfiant. Il est lassé et fatigué des experts qui donnent trop d’importance à leurs déclarations ; aussi devient-il de plus en plus prudent à l’égard de ceux qu’il choisit de croire. Au lieu de blâmer le public, cherchez premièrement à « faire le ménage dans vos rangs ».
La solution ne consiste pas à dissimuler les difficultés et les désaccords par crainte de ce que les « créationnistes » pourraient dire. La franche vérité, l’honnêteté et la transparence sont la solution. Réfléchissez aux limites des faits et au point de départ de votre interprétation. Comprenez comment les deux se mélangent dans ce que vous communiquez. Cela ne signifie pas que toutes vos interprétations soient fausses, mais qu’elles doivent être présentées pour ce qu’elles sont vraiment : des interprétations basées sur vos présomptions et votre vision du monde.
Pour cela, il faut notamment être prêt à cesser d’infantiliser votre public avec des mots destinés à façonner sa compréhension, sans l’impliquer activement. Cessez de « chicaner » sur des mots tels que fait, théorie et hypothèse (même si c’est “eux” qui ont commencé). Cessez de présenter votre « message » d’une manière qui est davantage motivée par la peur d’une « pirouette » créationniste que par la volonté de communiquer avec précision.1 Des milliers de créationnistes de la Jeune-Terre connaissent par cœur les déclarations de Stephen Jay Gould, mais il y a une raison pour laquelle il est considéré comme un scientifique honnête au sujet de l’évolution, une théorie à laquelle il croyait et dont il s’est détourné. En revanche, Richard Dawkins est considéré d’une manière… bien différente.
C’est peut-être beaucoup demander, mais c’est essentiel si vous souhaitez que votre travail conserve une certaine crédibilité. Des défis encore plus importants vous attendent.
Vous devrez par exemple admettre que ce n’est pas une aberration scientifique d’affirmer que la vie, sous toutes ses facettes, présente des éléments qui peuvent être mieux compris comme étant le résultat d’une certaine forme d’intelligence. Il est ridicule de refuser d’admettre qu’une telle conclusion puisse être scientifique. Non seulement cela renforce la méfiance déjà évoquée à l’égard des spécialistes, mais cela vous coupe radicalement des voies valables de la recherche et de la découverte.
Le site Internet IntelligentDesign.org déclare très simplement : « La théorie du dessein intelligent soutient que certaines caractéristiques de l’Univers et des êtres vivants s’expliquent mieux par une cause intelligente que par un processus non guidé comme la sélection naturelle. »2 Qu’elle soit vraie ou fausse, sommes-nous prêts à accepter que cette affirmation soit scientifique et qu’elle peut être évaluée scientifiquement ?
Si les motivations des théoriciens du dessein intelligent sont suspectes parce que beaucoup d’entre eux croient en Dieu, les motivations des théoriciens de l’évolution ne devraient-elles pas être suspectes parce que beaucoup d’entre eux ne croient pas en Dieu ? Beaucoup des partisans les plus ardents et les plus passionnés de la théorie de Darwin le sont car cette idéologie correspond à leurs penchants métaphysiques. En parlant des premiers naturalistes et chercheurs qui ont adhéré à la théorie de l’évolution, l’évolutionniste et philosophe Michael Ruse a noté que, « comme tout le monde, ils avaient été initialement attirés par l’évolution précisément en raison de ses aspects quasi religieux… »3
Le travail de ces premiers évolutionnistes doit-il être remis en question en raison de leur « métaphysique » ou de leur « philosophie » ? Faut-il écarter leurs idées et leurs recherches car ils ont été séduits par les « aspects quasi religieux » de l’évolution ? De telles normes ne devraient-elles pas s’appliquer dans les deux sens ?
Peut-être me trouverez-vous optimiste, mais je pense qu’au fond d’eux-mêmes, la plupart des évolutionnistes ont conscience que les barrières philosophiques qu’ils érigent contre le dessein intelligent ne sont que des manœuvres tactiques, ou des positions prises, pour mettre l’ennemi mal à l’aise et non pour servir les objectifs de la science.
Reconsidérez la question. Acceptez le mouvement du dessein intelligent comme une initiative scientifique, au moins sur le principe, et récupérez ainsi une certaine autorité pour le concept consistant à suivre les preuves là où elles mènent. Cette idée est bien plus au cœur de ce que la science devrait être plutôt que de l’approche consistant à « rejeter les apostats et brûler les hérétiques » à laquelle nous assistons si souvent de nos jours.
Il existe en effet des preuves réelles montrant que le dessein intelligent a du mérite. Nous ne tenterons pas de les résumer ici, mais elles existent. Laissez-vous guider par les propos de Francis Crick et de Richard Dawkins, deux scientifiques de renom qui soutiennent l’évolution. Crick a averti que « les biologistes doivent constamment garder à l’esprit que ce qu’ils voient n’a pas été conçu, mais a plutôt évolué ».4 Dawkins fournit un témoignage similaire : « La biologie est l’étude d’objets complexes qui donnent l’apparence d’avoir été conçus dans un but précis. »5
En y réfléchissant bien, leurs dénégations se transforment en aveux ironiques. En posant un regard scientifique sur les preuves réelles, leurs « aveux » vont bien plus dans le sens d’un soutien à la conception de la vie que beaucoup acceptent de l’admettre. Après tout, si les biologistes doivent « constamment » garder à l’esprit que la vie n’a « pas été conçue », c’est peut-être parce que les preuves qu’ils rencontrent régulièrement plaident avec force dans la direction opposée. Les apparences ne sont pas toujours trompeuses.
Imaginez les avantages qu’il y aurait à prendre au sérieux ceux qui développent actuellement les théories du dessein intelligent, même si vous n’êtes pas d’accord avec leurs conclusions. Comme nous l’avons souligné, beaucoup de vos collègues et de vos pairs, qui partagent votre idéologie, ont déjà avoué le mérite de leur travail. La microbiologiste Lynn Margulis avait ainsi admis que leur analyse des faiblesses de l’évolution était valable, même si elle n’était pas d’accord avec leurs conclusions.6 Thomas Nagel a déclaré à propos de l’évolution et du dessein intelligent : « Soit tous les deux sont de la science, soit ils n’en sont pas. »7
La science peut-elle être libérée afin de rechercher à nouveau la vérité et de suivre véritablement les preuves, peu importe où elles mènent ?
À l’attention des créationnistes
Il est vrai que certains évolutionnistes sont des exemples vivants de la condamnation de Paul : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître […] Car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres » (Romains 1 :18-19, 21).
Cela étant, ces paroles ne s’appliquent pas à tous les évolutionnistes. Beaucoup d’entre eux admirent sincèrement la même création que vous, même s’ils ne comprennent pas qu’il s’agit d’une « création ». Ils voient le monde à travers le prisme qui leur a été donné, le seul prisme mis à leur disposition par les systèmes éducatifs d’une grande partie du monde.
Il y a des moments où il faut s’opposer aux mots, aux idées et aux orateurs, de la même manière qu’Élie s’opposa aux adorateurs de Baal. Parfois, le ridicule est en effet l’arme de prédilection d’un bon guerrier.
Mais un discours plus aimable, même lorsqu’il s’adresse à ceux qui ne croient pas, est aussi un outil très précieux : « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4 :5-6).
En ce qui concerne la Bible, il faut vous féliciter d’avoir compris que « l’Écriture ne peut être anéantie » (Jean 10 :35). Dieu est véritable et ce qu’Il révèle l’est tout autant.
Cependant, il y a au moins deux choses à reconsidérer dans votre raisonnement. Tout d’abord, il faut comprendre que si la parole de Dieu est la vérité (Jean 17 :17), alors nous devons la laisser nous enseigner et ne pas lui imposer nos idées. Nous devons aussi reconnaître que respecter la Bible signifie aussi respecter lorsqu’elle ne dit rien.
Beaucoup d’entre vous ont longtemps résisté à l’énorme pression qui les poussait à abandonner et à embrasser une vision du monde où Dieu n’aurait pas Sa place, une vision qui cherche à L’expulser de Sa propre création. Ce genre de courage est inhabituel de nos jours. C’est le genre de courage que Dieu recherche dans un monde où les individus « qui se tiennent à la brèche » sont de plus en plus rares (voir Ézéchiel 22 :30).
Notre conseil n’est pas d’abandonner votre dévotion à la Bible, mais de l’étendre et de l’approfondir, afin de développer l’amour que vous possédez pour les Écritures.
Une vie consacrée à la vérité divine exige une volonté de changement et la poursuite passionnée de possibilités qui semblent parfois contre nature et inconfortables, des possibilités que Dieu Lui-même peut nous révéler par l’intermédiaire de Sa parole. Dans Actes 17 :34, nous voyons que Denys l’Aréopagite et Damaris, des convertis athéniens du premier siècle, abandonnèrent les croyances religieuses qu’ils avaient connues depuis leur naissance afin de suivre les paroles de vérité qu’ils avaient entendues de la bouche de l’apôtre Paul. Leurs idoles étaient peut-être confortables, mais la vérité était plus importante pour eux.
Respecter véritablement la parole de Dieu consiste à respecter ce qu’elle dit réellement, pas à s’accrocher à ce que nous supposons qu’elle dit. De nombreux Juifs du premier siècle furent confrontés à un tel défi lorsque leur Messie marcha parmi eux en expliquant, d’une part, que leurs idées à propos des Écritures étaient erronées et que, d’autre part, ce qu’Il leur enseignait était vraiment ce que les Écritures disaient.
Dans la recherche de la vérité, il est essentiel d’être ouvert à la possibilité que les enseignements bibliques soient parfois différents des idées préconçues que nous avons. Paul loua l’attitude des Béréens pour leur ouverture d’esprit et leur volonté d’examiner les Écritures afin de confirmer la véracité de son message (Actes 17 :10-12). Mais nous pourrions rapidement oublier qu’ils ne se contentaient pas de prouver la véracité du message de Paul en se tournant vers la Bible. Ils montrèrent aussi qu’ils étaient prêts à abandonner leurs idées préconçues sur la Bible si de nouvelles preuves montrant ce qu’elle dit réellement leur étaient présentées.
Dans leur cas, il ne s’agissait pas de déterminer l’âge de la Terre, mais ils étaient prêts à examiner certaines de leurs conceptions les plus profondes du plan de Dieu, la manière dont Il agit ou n’agit pas dans le monde, ainsi que la nature de leurs véritables obligations envers Lui. En vérité, ces questions relatives à nos croyances sont bien plus importantes que le fait de savoir si la Terre est ancienne ou récente. Et ce que la Bible révèle à leur sujet est encore plus surprenant.
Si vous avez le courage de commencer à explorer ces questions, je vous encourage à contacter notre bureau régional le plus proche de chez vous, afin d’obtenir un exemplaire gratuit de nos brochures intitulées La restauration du christianisme originel et Croyez-vous au véritable Évangile ? Si votre dévotion à la parole de Dieu est aussi passionnée que vous le pensez, vous souhaiterez assurément comprendre ce que la Bible déclare réellement.
À l’attention de tout le monde
L’origine de la vie et de l’humanité est un des mystères les plus importants que vous puissiez chercher à comprendre, affectant toutes les autres connaissances que vous pouvez posséder. Les idées exposées dans cet ouvrage présentent des réponses et des conclusions radicalement différentes.
Voici la question qui se pose à présent : quelles sont vos croyances à propos de l’origine de la vie ? Dans les limites d’une brochure aussi compacte que celle-ci, nous avons présenté des preuves scientifiques et bibliques que nous estimons à la fois pertinentes et convaincantes. Nous pensons que ces preuves soutiennent l’idée que la vie a une origine divine, que le monde est probablement beaucoup plus ancien que certains veulent le dire et que l’humanité a une origine unique, relativement récente, dans le jardin d’Éden, ayant été créée à l’image de Dieu, comme le décrit la Genèse.
Néanmoins, ces faits ne sont d’aucune utilité pour ceux qui y croient, à moins qu’ils agissent conformément à la vérité qu’ils révèlent. Si Dieu vous a créé, Il l’a fait dans un but précis et Il est prêt à vous révéler ce but. Il est exposé dans les pages de la Bible, mais peu de gens le trouvent. Beaucoup ne sont même pas conscients de l’existence d’un tel but.
Si vous êtes convaincu(e) de la réponse biblique à la question de savoir comment la vie est apparue sur Terre, vous souhaiterez peut-être commencer à explorer une question bien plus importante : pourquoi Dieu nous a-t-Il créés ? Nous disposons d’une brochure pour vous aider à répondre à cette question, elle s’intitule Quel est le but de de la vie ? Contactez simplement le bureau régional le plus proche de chez vous, dont la liste figure à la fin de cet ouvrage, ou connectez-vous sur notre site Internet MondeDemain.org afin d’en commander un exemplaire gratuit. Si vous avez compris l’origine de la vie, vous devez désormais comprendre le but de la vie.
Notes bibliographiques
Chapitre 1 : L’enjeu le plus important
- The Meaning of Evolution, George Gaylord Simpson, édition révisée, Yale University Press, 1967, p. 345
- Entretien avec Richard Dawkins, Thomas Bass, Omni, janvier 1990, p. 60
- “Darwinism : Science or Naturalistic Philosophy ? – A debate between William B. Provine and Phillip E. Johnson at Stanford University”, 30 avril 1994, Access Research Network, consulté le 1er novembre 2018
- New Poll Reveals Evolution’s Corrosive Impact on Beliefs about Human Uniqueness, Discovery Institute, 2016, p. 1
- “It’s Time to Make Human-Chimp Hybrids”, David P. Barash, Nautilus, 8 mars 2018
- The Great Ape Project : Equality Beyond Humanity, Paola Cavalieri, St. Martin’s Press, 1993, pp. 85-87
- “Definition of Evolutionary Terms”, Evolution Resources, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, consulté le 12 janvier 2018. (Lorsque nous parlons d’évolution dans cet ouvrage, nous nous concentrons sur ce que les académies nationales définissent comme la macro-évolution.)
- L’horloger aveugle, Richard Dawkins, éditions Robert Laffont, p. 21, traduction Bernard Sigaud
- Nous reconnaissons qu’il existe d’autres idées sur la manière dont l’évolution aurait pu se produire. Toutefois, au moment de publier cette brochure, l’évolution darwinienne reste la conception la plus étayée et la plus universellement acceptée quant à la manière dont l’évolution peut se produire par des moyens naturels. Cette déclaration ne vise pas à exclure, par exemple, les effets de la dérive génétique et d’autres influences, ni à rejeter les idées novatrices, telles que l’évo-dévo (biologie évolutive du développement). Elle vise plutôt à montrer que la vision darwinienne, selon laquelle la sélection naturelle agit sur des variations aléatoires, continue à occuper la première place en tant que théorie de base dans le domaine de la biologie. Il y a une raison pour laquelle beaucoup, y compris dans les publications scientifiques, continuent à confondre le darwinisme et le concept d’évolution, faute d’une alternative aussi crédible expliquant le mécanisme de l’évolution. L’affirmation selon laquelle l’évolution s’est produite naturellement, d’une manière matérialiste et aveugle, est vide de sens à moins qu’un mécanisme plausible, naturel, matérialiste et non planifié ne soit proposé. En l’absence d’un tel mécanisme, l’affirmation selon laquelle l’évolution devrait être considérée comme un “fait” est ironiquement une demande explicite d’accepter sa vérité sur la “foi” qu’un tel mécanisme doive exister. Il faut aussi affronter d’autres affirmations qui peuvent sembler beaucoup plus intuitives et exiger bien moins de “foi”. Cet aspect sera abordé au chapitre 5 de la présente brochure.
- Évolution : les preuves, Jerry Coyne, édition Markus Haller, pp. 14-15, traduction Florian Cova
- Nous reconnaissons que certains affirment que le nombre est peut-être un peu plus élevé, comme 10.000 ou 12.000 ans, mais ces différences ne sont pas pertinentes pour notre propos.
- Mind and Cosmos : Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Thomas Nagel, Oxford University Press, 2012, pp. 5-6
Chapitre 2 : Ce que révèlent les fossiles
- L’origine des espèces, Charles Darwin, éditions Flammarion, p. 232, 344, traduction Edmond Barbie
- “The Episodic Nature of Evolutionary Change”, Steven Rose, The Richness of Life : The Essential Stephen Jay Gould, W.W. Norton & Company, 2007, p. 263
- “Evolution as Fact and Theory”, Stephen Jay Gould, Hen’s Teeth and Horse’s Toes : Further Reflections in Natural History, W.W. Norton & Company, 2007, p. 259
- Sudden Origins : Fossils, Genes, and the Emergence of Species, Jeffrey Schwartz, John Wiley & Sons, 1999, p. 3
- Évolution : Une théorie en crise, Michael Denton, éditions Flammarion, pp. 163-164, traduction Nicolas Balbo
- “Denying Darwin : David Berlinski and Critics”, David Berlinski et al., Commentary, septembre 1996
- L’origine des espèces, Charles Darwin, op. cit., pp. 372-373
- “The Cambrian Explosion”, C. J. Lowe, Science, volume 340, n°6137, juin 2013, p. 1170
Chapitre 3 : La preuve par les yeux
- L’origine des espèces, Charles Darwin, op. cit., p. 247
- Ibid.
- Évolution : les preuves, Jerry Coyne, op. cit., pp. 214-215
- Tout lecteur ayant entendu dire que les yeux des humains et d’autres vertébrés sont “obsolètes” parce que leurs rétines sont à l’inverse de ce qu’elles “devraient” être (et, par conséquent, une preuve supposée de l’absence d’un concepteur intelligent) trouvera la recherche réelle d’un grand intérêt (par opposition à la façon dont elle est souvent décrite de manière inexacte). De nombreuses raisons montrent que la rétine “inversée” est la conception optimale pour certaines espèces et que les “défauts” de conception invoqués par beaucoup sont en fait des “caractéristiques” maximisant par exemple l’accès aux nutriments pour les cellules rétiniennes et offrant d’autres avantages par rapport à la conception “à l’endroit” de la pieuvre, par exemple. L’article suivant de Ronald Kröger et Oliver Biehlmaier apporte davantage de détails à ce sujet : “Space-saving advantage of an inverted retina”, Vision Research, volume 49, n°18, 9 septembre 2009, pp. 2318-2321. Un article beaucoup plus ancien d’Alberto Wirth, Giuliano Cavallacci et Frederic Genovesi-Ebert démontre que ceux qui prétendent que la conception de l’œil des vertébrés est “obsolète” ignorent les faits ou ne s’y intéressent pas (“The advantages of an inverted retina”, Special Tests of Visual Function : Basic Problems and Clinical Applications, Developments in Ophthalmology, volume 9, 1984, pp. 20-28).
- “The cellular and molecular mechanisms of vertebrate lens development”, Aleš Cvekl et Ruth Ashery-Padan, Development, volume 141, n°23, 2014, pp. 4432-4447
- Les travaux de Dan-Erik Nilsson et Susanne Pelger sont souvent cités (bien que parfois grossièrement mal interprétés) comme une preuve montrant que de telles étapes sont réalisables et peuvent se produire dans une succession relativement courte. Ceux qui prétendent cela devraient lire l’étude de plus près, ou du moins plus honnêtement, car Nilsson et Pelger déclarent qu’ils ont fait exactement le genre de simplifications excessives dont nous avons parlé dans ce chapitre, reconnaissant qu’ils ont “délibérément ignoré” ces complications. Selon leurs propres termes, “parce que les yeux ne peuvent pas évoluer seuls, nos calculs ne disent pas combien de temps il a fallu pour que les yeux évoluent au sein des différents groupes d’animaux” (“A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve”, Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, volume 256, n°1345, avril 1994, pp. 53-58).
- “Evolving Evolution”, Israel Rosenfield et Edward Ziff, The New York Review of Books, 11 mai 2006
- Ibid.
- Il convient de noter que Rosenfield et Ziff mentionnent ces échecs de l’évolution dans le contexte des livres qu’ils analysent dans leur article, présentant des solutions pleines d’espoir au problème, comme le rôle des gènes Hox. Il s’agit là d’un autre exemple de ce que l’auteur Casey Luskin a appelé les “confessions rétroactives d’ignorance” des évolutionnistes. De nombreux scientifiques semblent beaucoup plus disposés à admettre une faiblesse de longue date dans leurs théories seulement après qu’une solution possible a été trouvée. Jusqu’à ce moment-là, ils préfèrent se taire.
- “Letter from Charles Darwin to Asa Gray”, 8 ou 9 février 1860, Darwin Correspondence Project
Chapitre 4 : L’univers de la cellule
- “DNA as information”, Peter R. Wills, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Mathematical, Physical and Engineering Sciences, volume 374, n°2063, mars 2016
- “Comparative Analysis of Noncoding Regions of 77 Orthologous Mouse and Human Gene Pair”, Niclas Jareborg et al., Genome Research, volume 9, n°9, 1999, p. 816
- “Eye”, The Human Protein Atlas, consulté le 18 novembre 2018
- Pour faire simple, l’ARN se présente sous deux formes majeures : l’ARN messager (ARNm) et l’ARN de transcription (ARNt). Le premier ressemble à la moitié d’une molécule d’ADN, construite pour correspondre à un “barreau” de l’échelle de l’ADN et contenant l’information de ce morceau d’ADN. L’ARNt existe en petits morceaux attachés à des acides aminés spécifiques. Lorsque les molécules d’ARNt amènent les acides aminés qui leur sont associés dans une séquence qui correspond aux éléments ordonnés de l’ARNm, contenant l’information copiée de l’ADN, les protéines sont assemblées acide aminé par acide aminé.
- Dans un sens, il s’agit d’une grande simplification. Les biologistes ont appris que non seulement l’ADN, mais aussi les informations réglementaires concernant la manière dont les gènes sont exprimés, que certains gènes soient exprimés ou non, sont également transmis. Nous en apprenons toujours plus sur les subtilités de la programmation et du patrimoine génétiques. Toutefois, il ne s’agit pas d’une simplification excessive inappropriée pour les besoins de cette étude.
- The Edge of Evolution, Michael Behe, Simon & Schuster, 2008, p. 11
- Arrival of the Fittest : How Nature Innovates, Andreas Wagner, Penguin Random House, 2015, p. 5
- “Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of Escherichia coli”, Zachary Blount, Christina Borland et Richard Lenski, Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 105, n°23, juin 2008, pp. 7899-7906
- Ibid.
- “Experimental evolution, loss-of-function mutations, and ‘the first rule of adaptive evolution’”, Michael Behe, The Quarterly Review of Biology, volume 85, n°4, décembre 2010
- “Selforganization of Matter and the Evolution of Biological Macromolecules”, Manfred Eigen, Die Naturwissenschaften, volume 58, n°10, octobre 1971, pp. 465-523
- Arrival of the Fittest, Andreas Wagner, op. cit., p. 4
- “Estimating the prevalence of protein sequences adopting functional enzyme folds”, Douglas D. Axe, Journal of Molecular Biology, volume 341, n°5, août 2004, pp. 1295-1315
- “The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions : A Case Study from the Biotin Pathway”, Ann K. Gauger et Douglas D. Axe, BIO-Complexity, n°1, 2011, pp. 1-17
- “Evolution : A Story Without a Mechanism”, Matti Leisola, dans Theistic Evolution : A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, J.P. Moreland, Crossway, 2017, pp. 143-144
- Ibid., p. 143
- Ibid., p. 157
- “A Scientific Scandal ? An Exchange Between David Berlinski and His Critics”, David Berlinski et al., Commentary, juillet-août 2003
Chapitre 5 : Des montagnes et des lunes
- “Denying Darwin”, David Berlinski, op. cit.
- “Billions and Billions of Demons”, Richard C. Lewontin, The New York Review of Books, 9 janvier 1997
- Ibid.
Chapitre 6 : La Terre est-elle jeune ? Comprendre Genèse 1
- Sur le site Internet du Monde de Demain, nous disposons de ressources gratuites pouvant aider les personnes intéressées à explorer ces questions, telles que nos brochures Le Dieu réel : preuves et promesses ou La Bible : réalité ou fiction ?
Malgré les fausses affirmations de certains philosophes et scientifiques athées selon lesquelles la foi est une “croyance sans preuve”, le Dieu de la Bible nous invite à examiner Ses affirmations et à les mettre à l’épreuve (par exemple, Psaume 34 :9 et Malachie 3 :10), en notant que Son existence est révélée dans la création qu’Il a accomplie (Romains 1 :18-21). - “Bill Nye Debates Ken Ham”, filmé le 4 février 2014 à Petersburg (à partir de 36’13”), consulté le 30 octobre 2018
- Il convient de noter que la position officielle de Answers in Genesis, l’organisation religieuse de Ken Ham, est spécifiquement celle du présuppositionnalisme. Nous croyons effectivement que la Bible est la parole parfaite et inspirée de Dieu, et nous sommes d’accord avec Answers in Genesis sur ce point, mais les commentaires dans ce chapitre ne sont pas une approbation de cette philosophie. Comme nous l’avons mentionné, nous croyons que Dieu invite les gens à mettre Sa parole à l’épreuve et à prouver qu’elle vient bien de Lui. Nous renvoyons les lecteurs intéressés à notre brochure gratuite La Bible : réalité ou fiction ?
- Nous n’approuvons pas toutes les conclusions de ces livres, mais deux ressources utiles à cet égard sont The Grand Canyon, Monument to an Ancient Earth de Greg Davidson (Kregel Publications, 2016) et The Bible, Rocks and Time : Geological Evidence for the Age of the Earth (InterVarsity Press, 2008) de David Young et Ralph Stearley. Les preuves discutées vont de l’aspect technique au simple raisonnement (par exemple, si les couches géologiques ont été déposées par le déluge, comment de telles couches peuvent-elles exister sous l’Euphrate, un fleuve mentionné dès Genèse 2 :14 ?)
- “2494a (tōhū)”, Ronald F. Youngblood, Theological Wordbook of the Old Testament, Laird Harris, Moody Press, 2004
- Comme dans le titre de l’ouvrage Unformed and Unfilled : A Critique of the Gap Theory, de Weston Fields, Master Books, 2005
- The Lie : Evolution/Millions of Years, Ken Ham, Master Books, 2012, p. 208
- The Living Bible, Tyndale House Publishers, 1971
- “Genesis 1 :2”, Richard Elliott Friedman, Commentary on the Torah, Harper Collins, 2001
- Traité des principes, Origène, tome 1, livre 2, chapitre 9, texte critique de la version de Rufin, éditions du Cerf, p. 355, traduction Henri Crouzel (voir également Traité des principes, livre 3, chapitre 5, §2-4)
- A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Marcus Jastrow, volume 2, 1903, p. 1262 (entrées pour צדיא et mots apparentés)
- Geology and Revelation : Or the Ancient History of the Earth, Considered in the Light of Geological Facts and Revealed Religion, Gerald Molloy, G.P. Putnam & Sons, 1870, p. 311
- Ibid.
Chapitre 7 : La rébellion, la ruine et la restauration
- The Lie, Ken Ham, op. cit., pp. 207-208
- The Bible, Rocks and Time : Geological Evidence for the Age of the Earth, Davis Young et Ralph Stearley, InterVarsity Press, 2008, p. 44
- Nous encourageons les créationnistes de la Jeune-Terre qui s’intéressent à Exode 20 :11 à envisager d’obéir au commandement contenu dans ce verset, tout comme l’a fait leur Sauveur, au lieu de l’utiliser uniquement dans le but de réfuter une interprétation biblique qu’ils n’apprécient pas. Pour les personnes intéressées, nous vous recommandons de lire notre brochure Quel est le jour du sabbat chrétien ?
Chapitre 8 : Qu’en est-il des dinosaures ?
- “Dinosaur Shocker”, Helen Fields, Smithsonian Magazine, mai 2006
- Ibid.
- “Paluxy River Tracks in Texas Spotlight”, Elizabeth Mitchell, Answers in Genesis, 14 avril 2012
- “Searching for the ‘Magic Bullet’”, Ken Ham, Creation, mars 2003, pp. 34-37
Chapitre 9 : Qu’en est-il de l’homme ?
- “Results of major new survey on evolution”, communiqué de presse, Science & Religion : Exploring the Spectrum, 5 septembre 2017
- Science and Human Origins, Ann Gauger et al., Discovery Institute Press, 2012, p. 45
- Ibid.
- Pour en apprendre davantage sur le plan de Dieu et le but de l’humanité, vous pouvez lire notre brochure gratuite intitulée Quel est le but de la vie ?
- Il convient de noter que le mot “homininé” peut prêter à confusion. Il désignait auparavant toutes les lignées ancestrales présumées menant non seulement à l’homme, mais aussi, par exemple, au chimpanzé, au gorille et à l’orang-outan. Cette catégorie est désormais appelée “hominidé”, tandis que le terme “homininé” est réservé à la lignée censée mener plus directement à l’humanité, c’est-à-dire après que la lignée humaine s’est séparée de son dernier ancêtre commun partagé avec ces animaux. Cependant, même au sein de la lignée des homininés, certaines espèces ne sont pas supposées avoir conduit à l’homme moderne, mais constituer des branches propres aujourd’hui éteintes. Comme l’explique ce chapitre, la précision exigée par ces mots est en contradiction avec la confusion entourant ce qu’ils désignent.
- The Panda’s Thumb : More Reflections in Natural History, Stephen Jay Gould, W.W. Norton & Company, 1980, p. 126
- Bones of Contention : Controversies in the Search for Human Origins, Roger Lewin, University of Chicago Press, 1987, p. 21
- “How reliable are human phylogenetic hypotheses ?”, Mark Collard et Bernard Wood, Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S. National Academy of Sciences, volume 97, n°9, avril 2000, p. 5003
- Bones of Contention, Roger Lewin, op. cit., p. 26
- Bones of Contention : A Creationist Assessment of Human Fossils, Marvin L. Lubenow, Baker Publishing Group, 2007, pp. 300-301
- “Skull suggests three early human species were one”, Sid Perkins, Nature, 17 octobre 2013
- Ibid.
- “Skull of Homo erectus throws story of human evolution into disarray”, Ian Sample, The Guardian, 17 octobre 2013, modifié le 18 octobre 2013
- Ibid.
- Science and Human Origins, Ann Gauger, op. cit., p. 71
- “‘Earliest’ evidence of modern human culture found”, Nick Crumpton, BBC News, 31 juillet 2012
Chapitre 10 : Où allons-nous maintenant ?
- “Evolution as a fact ? A discourse analysis”, Jason Jean et Yixi Lu, Social Studies of Science, volume 48, n°4, août 2018, pp. 615-632
- “What Is Intelligent Design ?”, consulté le 3 novembre 2018
- “Is Evolution a Secular Religion ?”, Michael Ruse, Science, volume 299, n°5612, mars 2003, p. 1524
- What Mad Pursuit : A Personal View of Scientific Discovery, Francis Crick, Basic Books, 1988, p. 138
- L’horloger aveugle, Richard Dawkins, op. cit., p. 15
- “Lynn Margulis Says She’s Not Controversial, She’s Right”, Dick Teresi, Discover, avril 2011
- “Public Education and Intelligent Design”, Thomas Nagel, Philosophy & Public Affairs, volume 36, printemps 2008, p. 201



